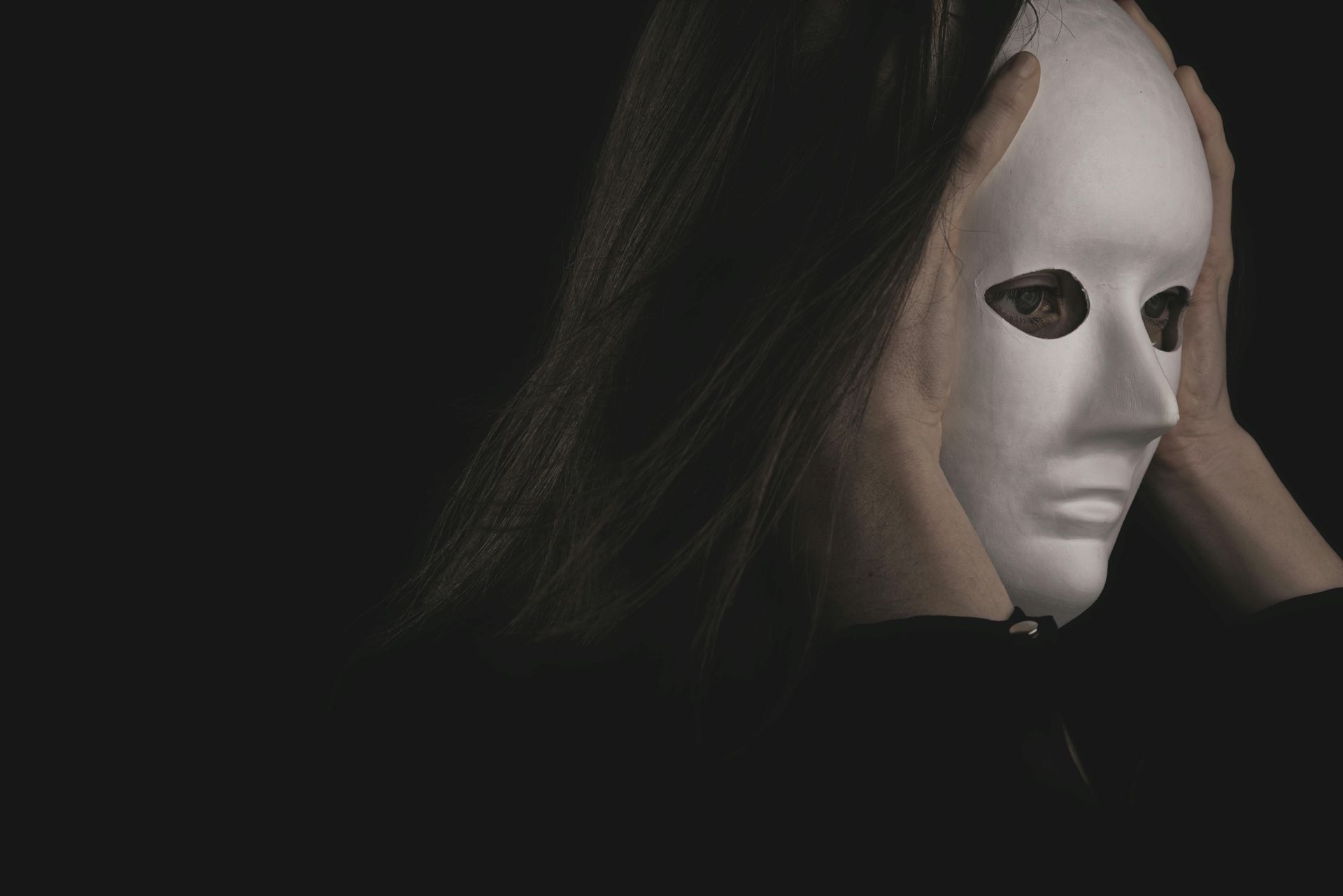« Avec toi, c'est jamais bon ! » La double contrainte
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
« Quoi que tu fasses, tu as tort »
Il existe des liens qui étranglent, sans se refermer. Pas de main qui serre, pas de cris qui claquent. Juste des mots qui glissent, des regards qui désavouent, des gestes qui figent. Ce sont des scènes ordinaires — une discussion en couple, une injonction professionnelle, une parole parentale — dans lesquelles une phrase, une réponse, une injonction peut faire perdre pied, jusqu’à perdre la logique du monde.
“Fais ce que tu veux, mais si tu le fais, je saurai que tu ne m’aimes pas.”
Il ne s’agit plus de choisir, il s’agit de trahir quoiqu’on fasse.
Cette forme particulière d’impasse a été conceptualisée sous le nom de double contrainte par Gregory Bateson et ses collègues dans les années 1950, dans le cadre de leurs recherches sur la schizophrénie (Bateson et al., 1956). Loin de se limiter au champ de la psychose, cette dynamique structurelle s’est révélée opérante dans de nombreuses formes de souffrance relationnelle contemporaine, qu’il s’agisse de l’emprise pathologique conjugale, du harcèlement managérial ou des violences éducatives paradoxales (Watzlawick et al., 1967 ; Courtois, 2023 ; Daniel, 2021).
Appeler la double contrainte une dynamique structurelle, c’est dire que le problème n’est pas le contenu des échanges, mais l’architecture relationnelle qui les rend impossibles à penser : des injonctions contradictoires, une interdiction de les nommer, et un lien dont on ne peut pas se retirer. Loin d’être un concept figé, la double contrainte constitue ici le socle d’une clinique du paradoxe.

La mécanique d'un piège fichtrement efficace
La double contrainte n’est pas juste une contradiction. C’est un piège relationnel structuré, qui rend toute sortie non seulement impossible, mais inqualifiable. Elle repose sur trois conditions fondamentales.
D’abord, un attachement, où le lien affectif est important, voire perçu comme existentiel. (lire : Emprise, quand tu me tiens!). Cette première condition est souvent et largement sous-estimée : la double contrainte n’a pas la même force selon que nous parlons à un inconnu, à un collègue de passage, ou à une figure à laquelle notre sécurité intérieure est suspendue. Plus le lien compte, plus la double contrainte devient « incontournable » et « aliénant », parce qu’elle s’attaque à ce que l’attachement produit de plus primaire : la nécessité d’être reconnu, gardé, aimé, ou simplement de ne pas être abandonné. Dans ces configurations, l’autre n’est pas seulement un partenaire d’échange ; il est investi d’un pouvoir affectif et symbolique : sa validation fait tenir, sa désapprobation fait vaciller, son retrait fait menace. C’est là que nous rejoignons les logiques d’emprise comme description clinique d’un lien où la dépendance au regard de l’Autre devient une condition de survie psychique.
Ensuite, deux messages contradictoires, souvent envoyés sur deux canaux différents — un verbal et un non verbal, ou deux niveaux logiques distincts.
Enfin, l’interdiction de métacommuniquer : il est impossible de parler de ce paradoxe, de le nommer, de le critiquer, sous peine d’être disqualifié ou sanctionné.
Dans une entente interstructurelle (entre structures de personnalité), deux personnes peuvent se parler « sur le papier », partager des faits, des tâches, parfois même des affects, tout en butant très vite sur une première difficulté décisive : l’impossibilité de métacommuniquer. Cliniquement, cela désigne le moment où il devient impraticable de parler de la manière dont on se parle, c’est-à-dire de nommer le cadre de l’échange, les sous-entendus, les places, les effets produits, sans que cette tentative soit immédiatement disqualifiée, retournée contre celui qui parle, ou vécue comme une attaque.
C’est souvent là que l’entente se grippe : parce que, quand les structures ne « lisent » pas le lien et la relation avec les mêmes coordonnées, la métacommunication devrait jouer le rôle de pont symbolique (cela permet la co-construction). Or, ce pont s’effondre précisément au moment où il est nécessaire. L’un dit, avec une prudence parfois presque scolaire : « Quand tu me réponds comme ça, je me sens rabaissé, j’aimerais qu’on clarifie », et l’autre entend : « Tu m’accuses, tu dramatises, tu cherches un coupable. » À partir de là, on ne discute plus du lien, on discute de la légitimité même d’avoir voulu en parler. Et la relation se retrouve condamnée à tourner en boucle dans le contenu, alors que c’est la structure du lien (s’il y a lien) qui fait symptôme.
Dit autrement, l’impossibilité de métacommuniquer signe une zone où le langage ne sert plus à élaborer, mais à se défendre. Ce qui aurait dû devenir du symbolisable tombe dans une forme de Réel relationnel : ça agit, ça blesse, ça rigidifie, mais ça ne peut pas être nommé sans déclencher incendie, déni ou représailles. C’est, très concrètement, la première impasse : nous ne pouvons pas « parler du problème », parce que parler du problème devient le problème.
Il ne s’agit donc pas d’un simple dilemme. Dans un dilemme, on peut choisir, même au prix d’une perte. Dans la double contrainte, quel que soit le choix, le sujet est en faute (Bateson et al., 1956 ; Watzlawick et al., 1967). Le résultat est l’aliénation.
« Sois spontané. »
Une phrase apparemment anodine, mais qui contient un piège logique et relationnel. Si j’obéis, je ne suis plus spontané. Si je désobéis, je ne respecte pas l’injonction.
Dans ce type de situation,
aucun choix n’est bon. Voilà la double contrainte.

L’exemple que nous propose Paul-Claude Racamier (1992) permet avec clarté d’en comprendre les enjeux :
Une mère offre à son fils deux cravates. Le fils, voulant bien faire, met la première. La mère s’attriste ou s’indigne : « Donc tu n’aimes pas l’autre… » La fois suivante, il met l’autre cravate : même reproche, inversé, et n’en mettre aucune ne résoudra pas le problème. Alors, tentant de sortir du piège, le fils met les deux en même temps — et la mère le disqualifie à un autre niveau : « Tu es complètement fou ! » Autrement dit : choisir A est une faute, choisir B est une faute, et refuser le choix (en portant les deux ou aucune des deux) devient encore une faute, mais cette fois sur la « normalité », sur l’intégrité du Sujet.
Choisir c’est déjà être coupable. Tenter d’en sortir sans risquer de nuire au lien est impossible. Une double contrainte n’est donc ni un conflit entre des possibilités (« tu veux du sucré ou du salé? »), ni une contradiction qui oppose deux éléments incompatibles (« ne sors pas » vs « va prendre l’air ») ou une contradiction logique sur un plan métalinguistique (« je mens toujours »).
Les textes fondateurs soulignent que cette structure n’est pas ponctuelle. Elle est répétitive dans les interactions. Elle s’installe, se renforce, se normalise. Elle devient la cellule du lien où la victime est ligotée. Et c’est là que réside sa puissance délétère : elle fabrique un monde sans extériorité, sans repère, sans solution, entre les mains de l’auteur, où la logique même de la communication est inversée.
Pensée piégée, Langage retourné
Ce que produit la double contrainte, ce n’est pas d’abord un symptôme, mais une transformation de la pensée. Le sujet apprend que son initiative est dangereuse, que sa parole est inadéquate, que son ressenti est une faute. Il cesse d’élaborer. Il se met à deviner, à éviter, à se taire. Et ce silence n’est pas paisible : il est le fruit d’un effort constant pour survivre à un paradoxe invisible qui ne s’inscrit que dans la communication.
Dans ces configurations, la culpabilité est flottante, mobile, elle change de forme selon les réponses, mais elle reste omniprésente. Ce n’est pas ce que vous faites qui est fautif, c’est le fait même de choisir, de parler, d’être, d’oser exister à travers vous-même. À force de répétitions, la victime finit par intégrer la logique paradoxale comme une règle interne du lien. Une Loi (série de règles) dans laquelle le lien ne peut exister autrement. La victime finit par implicitement anticiper la double contrainte avant même qu’elle ne survienne. La victime « intériorise l’impossibilité du choix comme mode d’existence relationnelle ».
Les confusions mentales et les dissociations sont légion, entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons, et ce que nous pouvons encore exprimer. Le résultat sur le long terme amène une logique de désubjectivation, où nous développons le sentiment de n’être plus maitre de nos affects, de nos gestes, et de nos choix.
Une patiente me disait : « Si je me montre forte, il dit que je suis froide. Si je montre ma peine, il me reproche de faire la victime. » C’est une adaptation qui mène inéluctablement vers la résignation. La seule solution qui reste, quand toutes les autres tentatives sont punies.
Chez l’enfant soumis à des dynamiques de double contrainte par ses deux parents ou l’un des deux parents dans le cas de garde alternée, ces effets se manifestent souvent par : une inhibition chronique, des crises de rage sans raison identifiable ou suffisante, ou encore une soumission extrême qui masque une profonde confusion : « je dois faire ce que papa dit, sinon il se fâche. Il dit que je peux tout lui dire, mais quand je fais ce qu’il dit, il se fâche. Alors j’arrête de parler. » Ce silence n’est pas un symptôme, mais une réponse adaptée à une logique sans issue.
Bateson parlera à ce sujet d’un « deutéro-apprentissage pathologique » : la victime apprend à ne plus apprendre. Elle désapprend à penser ses choix. Elle intériorise l’idée que toute tentative de se positionner mène à la faute. Cela prépare le terrain à des troubles graves, sans que la structure même de la relation soit remise en cause.
Un « deutero-apprentissage » est un apprentissage qui ne porte pas seulement sur « quoi faire », mais sur les règles implicites du contexte (cf. Loi symbolique) :
- Apprentissage 1 : j’apprends une réponse (« quand on me critique, je me tais »).
- Deutero-apprentissage : j’apprends la règle du jeu (« dans cette famille, répondre = se faire punir ; se taire = survivre »).
C’est pour ça que, dans les relations, le « deutero- » renvoie souvent à ce qui organise le lien en profondeur : les codes, les interdits, ce qu’il est permis ou non de dire ou de faire, et donc… la possibilité ou non d’accéder à la métacommunication.

La désorganisation par le langage
Dans la clinique du trauma, la double contrainte agit comme une structure désorganisante, c’est-à-dire une modalité subjective et relationnelle qui, au contact, tend à défaire les repères plutôt qu’à les stabiliser : le cadre devient flou, les places se déplacent ou encore les règles changent sans être dites.
Le trauma ne réside pas uniquement dans la violence subie, mais dans l’impossibilité de penser, de symboliser, de dire ce qui a été vécu. Or, la double contrainte interdit cette élaboration : toute tentative de parole est désavouée, toute émotion est suspectée, toute lucidité est retournée contre celui qui la formule. La victime est exposée à des messages contradictoires portant sur des figures d’attachement ou d’autorité, sans pouvoir dire, comprendre ou fuir, ce qui constitue une condition traumatique durable (Levine, 2010). Ce désordre relationnel attaque directement la possibilité de penser, d’anticiper, ou de faire confiance à ses propres perceptions.
Ferenczi (1932), en décrivant la « confusion des langues » entre l’adulte et l’enfant, montrait déjà combien les « injonctions paradoxales » créaient une sidération psychique. L’enfant ne sait plus à quel registre obéir. Il doit deviner ce que veut l’Autre, tout en niant ce qu’il ressent, sans pouvoir trouver une solution qui lui permettrait de s’y soustraire. La logique traumatique s’installe là, dans cet écart impossible à symboliser, entre la perception, l’émotion et l’action (lire : Colonisé de l'intérieur : l'identification à l'agresseur).
Chez les patients ayant vécu une emprise pathologique, on retrouve souvent cette trace structurelle : une difficulté à nommer, une culpabilité informe, une impression d’être toujours « à côté ». Non pas juste parce qu’ils sont confus, mais parce qu’ils ont appris que toute clarté leur serait fatale.
L’emprise comme dispositif paradoxal
Dans l’emprise pathologique, la double contrainte ne survient pas par accident : elle devient le mode relationnel privilégié. Le lien est maintenu précisément grâce à l’impasse. L’auteur de l’emprise pathologique n’interdit pas toujours frontalement : il propose des choix qui comptent systématiquement un piège implicite ou explicite. Il exige une parole qu’il punira. Il appelle à la liberté pour mieux sanctionner toute autonomie. Il s’agit là d’une stratégie de confusion, parfois inconsciente, mais redoutablement efficace. C’est une « cage dont les barreaux sont invisibles ».
Les logiques d’emprise pathologique conjugale regorgent de phrases comme : « Tu peux partir si tu veux, mais personne ne voudra de toi » ou « Exprime-toi, mais attention à ce que tu dis ». Ce sont des doubles contraintes travesties en preuves d’amour - des paradoxes affectifs -, des pièges dont la victime finira par potentiellement s’accuser elle-même (Elkaïm, 2003). Dans certains cas, la contrainte devient même intériorisée sous forme d’auto-accusation ou de méfiance généralisée vis-à-vis de ses propres ressentis. Le lien toxique ou la relation toxique le devient non pas violence frontale, visible, tangible, mais par une disqualification insidieuse quasi systématique ou par renforcement intermittent (lire : Au bout de la laisse : Comprendre les conditionnements dans les relations d'emprise).
« Tu es libre, mais si tu pars, je me suicide. »
« Sois autonome, mais ne prends pas d’initiatives. »
« Tu peux parler, mais attention à ce que tu dis. »
Les travaux récents sur les institutions, la parentalité ou les dispositifs de contrôle social montrent que ces paradoxes ne sont pas isolés : ils sont souvent systématiques, reproduits à l’échelle des groupes, des normes, des discours (Ulysse, 2018 ; Tettamanti & Widmer, 2020 ; Røhnebæk & Breit, 2022 ; Hirji, 2021 ; Waldman, 2024).

Le paradoxe comme dispositif social
Si la double contrainte a d’abord été pensée dans un cadre familial, elle a depuis été identifiée dans les institutions, le monde du travail, les relations conjugales, et même dans le lien social.
Plusieurs exemples montrent comment les institutions produisent des injonctions paradoxales : « tu dois être autonome… mais on te contrôle en permanence », « exprime-toi librement… mais attention à ce qui tu dis », « détends-toi… sinon tu perds tes droits. »
Un patient actuellement au chômage qui sait vu « proposer une journée information non obligatoire » : « tu peux refuser, mais cela pourrait avoir un impact sur ton dossier… » Cette fausse liberté est une forme masquée de contrainte, typique des doubles contraintes modernes.
Ce que j’appelle des « propositions obligatoires » sont légion, pas uniquement dans le domaine du travail. Par exemple des dispositifs qui se présentent comme une offre d’aide, mais dont la logique institutionnelle fait que l’offre devient, de facto, une contrainte. C’est très visible dans le champ scolaire et socio-éducatif en Belgique : le CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Centre d'encadrement des élèves) côté néerlandophone, le PMS (Centres Psycho-Médico-Sociaux) côté francophone, et les équivalents en France, interviennent en principe dans une logique d’accompagnement, donc avec l’idée d’une alliance avec les parents. Sauf que le cadre est double : ces services ne peuvent réellement agir qu’avec le consentement parental, mais si ce consentement est refusé alors même que la situation est jugée préoccupante, la procédure impose de saisir l’échelon suivant — typiquement le SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse), puis éventuellement le SPJ (Service de Protection de la Jeunesse) — ce qui transforme le refus en déclencheur automatique d’un cadre plus contraignant.
On retrouve la même logique de seuil entre SAJ et SPJ : l’accompagnement « proposé » reste conditionné à l’adhésion, mais l’absence d’adhésion peut être interprétée comme un marqueur de risque et faire basculer vers une intervention plus directive. Cliniquement, c’est une mécanique paradoxale : il est dit aux parents « on veut travailler avec vous, avec votre accord », tout en signifiant, explicitement ou implicitement, « si vous n’êtes pas d’accord, nous devrons agir autrement ». Le résultat, dans certaines familles, n’est pas l’ouverture d’un espace de pensée, mais un effet de piège : l’accord ressemble à une soumission, le refus ressemble à une faute, et la relation d’aide peut se retrouver contaminée par une logique de contrôle. Là, la double contrainte n’est pas seulement dans la famille : elle est aussi produite par la structure du dispositif, qui tente de concilier alliance et protection, consentement et mandat, au prix d’une tension qui se rejoue dans chaque entretien.
Dans le monde du travail, Nataf (2009) et Dejours (1998) ont montré comment l’injonction simultanée à la performance et à l’initiative, couplée à l’absence de reconnaissance, produit du stress chronique, de l’absentéisme ou des comportements défensifs (cynisme, retrait, burn-out).
Ces doubles contraintes professionnelles se logent souvent dans des systèmes de contrôle managérial paradoxal : plus on exige de l’autonomie, plus on instaure des outils de surveillance. Le salarié est tenu responsable d’un résultat sur lequel il n’a aucune prise réelle. Il devient coupable d’une défaillance structurelle.
Dire « il suffit de partir » rate précisément ce que ces doubles contraintes font aux victimes. Dans le travail, nous ne quittons pas seulement un poste : nous quittons une source de revenus, un statut, parfois une identité, une appartenance, un récit de soi, et souvent une sécurité matérielle qui engage d’autres que soi. La contrainte économique, les responsabilités familiales, l’endettement, la rareté perçue d’alternatives, mais aussi la peur d’être disqualifié sur le marché (« si je pars, c’est que je n’ai pas tenu ») rendent la sortie coûteuse, parfois impossible à court terme. S’y ajoutent des mécanismes plus silencieux : l’intériorisation de la culpabilité (« si je n’y arrive pas, c’est que je suis insuffisant »), l’usure du stress chronique qui réduit la capacité de décision, et la capture par des dispositifs de contrôle paradoxaux qui demandent autonomie et performance tout en retirant la main sur les moyens. Dans ces conditions, « partir » devient un acte héroïque qu’on exige du salarié au moment même où l’organisation l’a déjà mis en position de faiblesse psychique et sociale. Cliniquement, l’injonction à partir fonctionne alors comme un déni : elle individualise ce qui relève d’une défaillance structurelle, et elle transforme la victime d’un système paradoxal en responsable de sa propre sortie.
La clinique du paradoxe
Sortir d’une double contrainte ne passe pas juste par une explication. Cela passe par un geste symbolique. Nommer la structure du discours, permettre au Sujet de l’apercevoir sans s’y enfermer davantage, introduire une disjonction là où il n’y avait que répétition. C’est un geste éthique avant d’être technique : récupérer des libertés individuelles qui n’auraient jamais dû être abandonnées.
Je crois qu’il ne faut pas se hâter de vouloir « résoudre » le paradoxe. Il faut l’écouter, le rendre visible, le désenclaver. Parfois, dire simplement : « Ce que vous décrivez est une impasse. Peu importe votre décision, vous ne pouvez que passer pour la mauvaise. Et ce n’est pas vous qui êtes incohérent, c’est ce qu’il vous dit qui ne l’est pas. » Ce type de reconnaissance change tout. Il ne libère pas immédiatement, mais il réintroduit du symbolique là où il n’y avait que du Réel brut (ce qui agit sur le corps, ce qui attaque l’identité, ce qui désorganise…). Notre rôle n’est pas de « trancher » entre les injonctions, mais de montrer la structure, d’offrir une métaposition, et de nommer l’impossible.
Je deviens alors le tiers manquant — celui qui ne se laisse pas piéger par le paradoxe, mais en dévoile la logique et soutient le sujet dans la traversée.
Les approches thérapeutiques systémiques (p.ex. l’idée est que, quand le système est coincé, plus de la même solution aggrave le problème ; on vise alors un changement de niveau 2 - un déplacement de cadre - plutôt qu’un meilleur « argument » ; Watzlawick et al., 1967), les stratégies d’Erickson (travaille souvent par utilisation : il s’appuie sur ce qui résiste au lieu de le combattre frontalement, avec des suggestions indirectes et des tâches qui transforment le symptôme en acte choisi, donc une signification choisie), la posture de contre-paradoxe d’Elkaïm (2003 ; ne pas se faire aspirer par la logique du système), ou encore l’usage du silence et du différé en psychanalyse, offrent autant de manières de rouvrir l’espace de pensée sans réimposer une logique externe au sujet. Encore une fois, il ne s’agit que d’offrir la possibilité au Sujet de se reapproprier. En psychanalyse, le silence et le différé ne sont pas une absence : ce sont des façons de ne pas répondre sur le mode imaginaire (rassurer, trancher, colmater), afin que le sujet puisse entendre ce qu’il dit, et produire son propre savoir plutôt que recevoir une « logique externe ». Des travaux cliniques et de recherche montrent que le silence peut soutenir réflexion, hésitation, approfondissement — et que le moment de l’intervention compte autant que son contenu (Fenner, 2024).
Notre responsabilité ne se situe pas dans la résolution, mais dans l’offre d’un lieu où ces paradoxes peuvent être nommés sans être redoublés. Un lieu où la parole n’est pas immédiatement interprétée, mais écouté. Un lieu où le silence est accueilli sans être soupçonné.

Pour conclure – Du Réel à la Réalité
La double contrainte est un piège sans mots. Elle agit dans les plis du langage, dans les silences, dans les ambiguïtés. Elle détruit le sens sans bruit. Et dans certains cas, elle devient un mode de vie. Le sujet n’a pas l’air enfermé. Il fonctionne. Il pense. Il aime. Il est attaché. Mais il vit dans une scène où toute issue est fausse.
Comprendre cette structure du discours, c’est ouvrir un nouvel espace clinique d’élaboration. C’est permettre de penser autrement le trauma, l’emprise pathologique, la disqualification psychique. C’est aussi interroger nos propres discours : où mettons-nous, sans le vouloir, l’autre en double contrainte ? Comment produisons-nous du paradoxe sous couvert d’accompagnement, d’aide, de soin, de guidance ?
Bibliographie
Bateson, G., Jackson, D. D., Haley, J., & Weakland, J. (1956). Toward a Theory of Schizophrenia. Behavioral Science, 1(4), 251–264.
Dejours, C. (1998). Travail, usure mentale. Bayard.
Elkaïm, M. (2003). Si tu m’aimes, ne m’aime pas. Paris : Seuil.
Fenner, C. (2024). Silence after narratives by patients in psychodynamic psychotherapy : a conversation analytic study. Front. Psychol. 15:13.
Ferenczi, S. (1932). Confusion de langues entre les adultes et l’enfant.
Hirji, S. (2021). Oppressive Double Binds. Ethics, 131(4).
Levine, P. A. (2010). In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness. North Atlantic Books.
Nataf, A. (2009). La double contrainte dans les organisations. Scribd.
Røhnebæk, M. T., & Breit, E. (2022). « Damned if you do and damned if you don’t »: a framework for examining double binds in public service organizations. Public Management Review, 24(7), 1001–1023.
Ulysse, C. (2018). Le contexte de l’hospitalisation sous contrainte de patients psychotiques. Revue Pratiques, 199.
Waldman, A. E. (2024). Legibility Double Binds. Boston University Law Review, 104(4).
Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967).
Pragmatics of Human Communication.
New York: Norton.
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Tous les articles