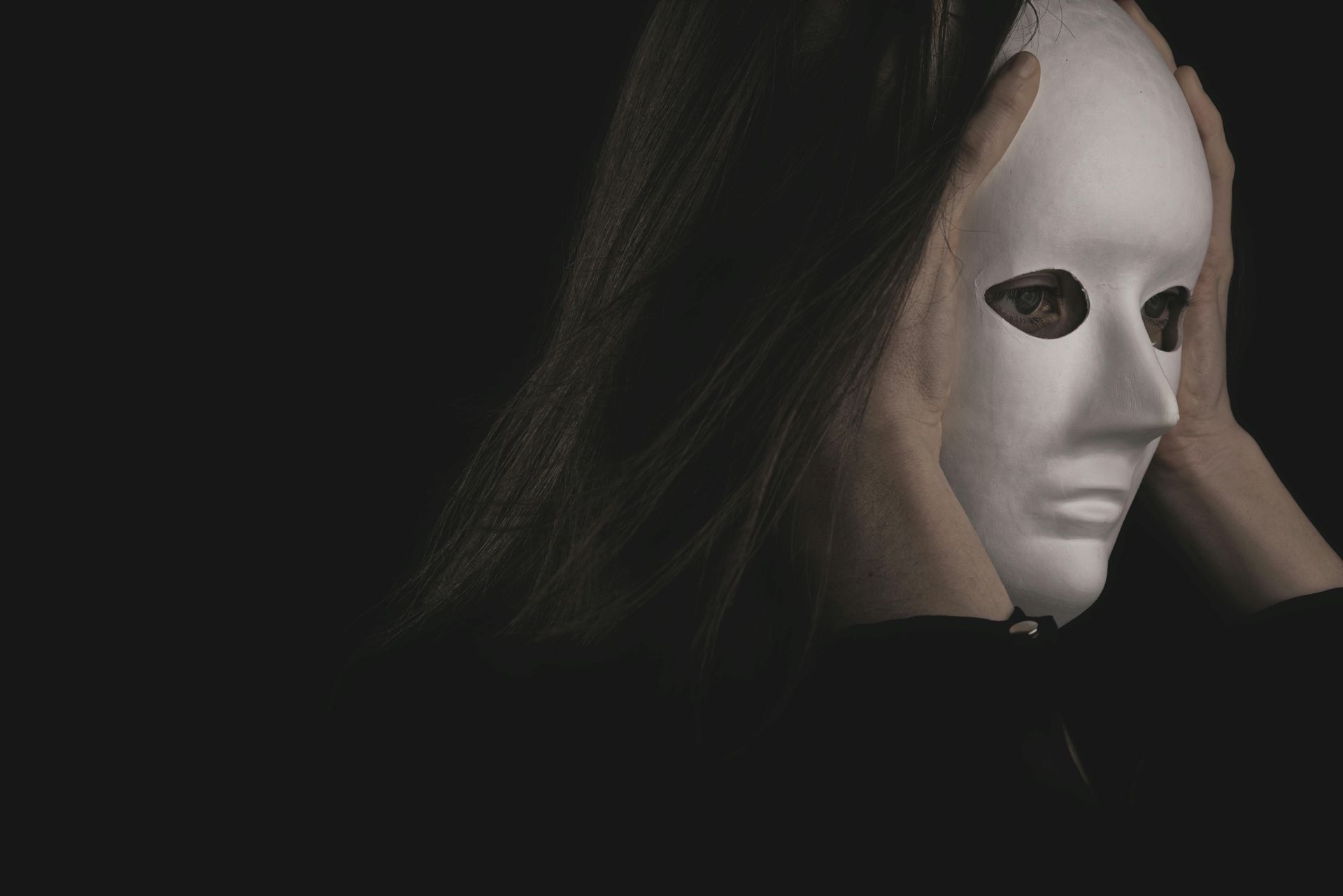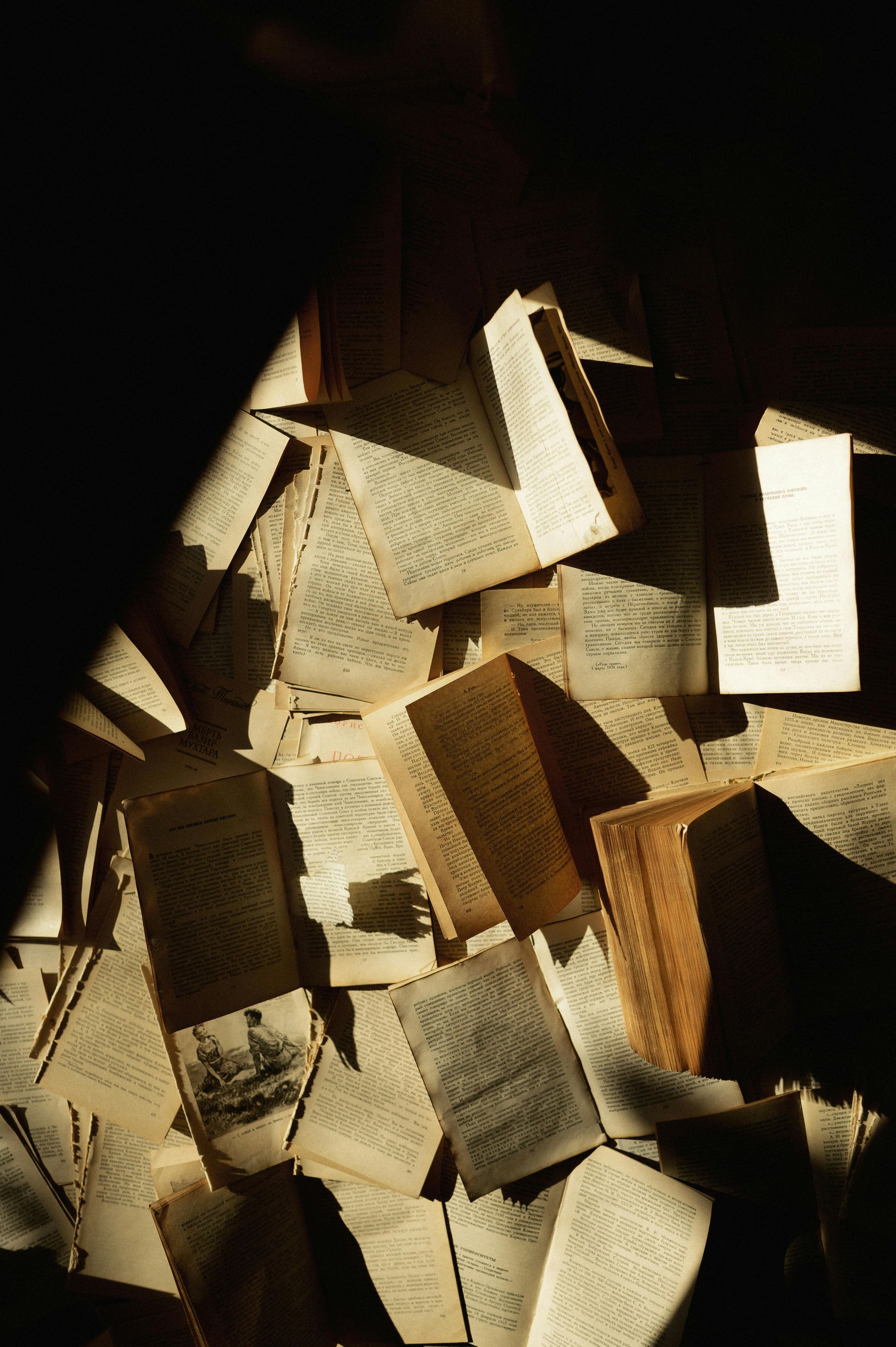Colonisé de l’intérieur L’identification à l’agresseur de Ferenczi : ce qui s’inscrit dans l’enfant, ce qui se rejoue dans l’adulte
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Des mots trop souvent mal utilisés
Pourquoi un enfant protège-t-il celui qui le violente? Pourquoi un adulte peut-il se sentir coupable d’avoir fui une relation violente ? Pourquoi l’excuse-t-il/elle encore ? Pourquoi certains passent-ils de la position de victime à celle d’agresseur ?
À ces questions, les réponses viennent souvent trop vite. Nous parlons de dépendance affective, de soumission, de volonté, etc. Certains évoquent même le syndrome de Stockholm comme un fourre-tout explicatif.
Or, le concept d’identification à l’agresseur
semble pouvoir nous offrir une réponse. Pourtant, il est souvent utilisé de travers.
Ce que Sandor Ferenczi décrit dans «
Confusion de langues entre les adultes et l’enfant » (1932/2023), c’est tout autre chose : un mécanisme psychique
violent et coûteux, où l’enfant
altère sa propre subjectivité
pour survivre à l’effondrement du lien. Il ne s’agit pas de consentement, mais de
sidération, de confusion entre affection et terreur, de transformation de soi pour rester vivant psychiquement. Ce texte est une tentative de restituer cette dynamique complexe, à travers quatre figures de l’identification à l’agresseur :
l’enfant victime, l’enfant auteur, l’adulte victime, l’adulte auteur.

L’enfant victime – Se couper pour ne pas exploser
Lorsque l’enfant est confronté à une violence insoutenable, traumatisante — agression physique, abus sexuel, dénigrement constant — et que cette violence provient d’un parent ou d’un membre proche de la famille, il ne peut ni fuir ni donner un sens à son vécu. Pour ne pas sombrer, il va s’effacer psychiquement, se soumettre entièrement à la volonté de l’agresseur, deviner ses envies, obéir à ses attentes. Ce n’est pas une stratégie ou un mimétisme, mais une autoplastie, une transformation du Moi pour rester acceptable par l’Autre (Ferenczi, 1932 ; Bertrand, 2009). Le Moi renvoi à l’image de soi que nous fabriquons pour nous reconnaître et nous rassurer, souvent en nous comparant aux autres ; l’Autre, c’est ce qui parle en nous sans que nous le contrôlions vraiment — les mots, les règles, les désirs qui viennent de la société, de nos parents, du monde.
L’agresseur
cesse d’être une figure extérieure : il est introjecté, c’est-à-dire littéralement « avalé » psychiquement, et devient une instance interne persécutrice. L’enfant s’approprie à la fois
la toute-puissance de l’agresseur et sa culpabilité, laquelle, selon Ferenczi, sert à «
colmater la faille traumatique ». Ce mouvement d’introjection va jusqu’à implanter un surmoi destructeur, étranger au sujet, et agissant à la manière d’un parasite psychique. Ce qu’on appelle un Surmoi d’emprunt (la Loi) ce n’est pas une instance morale qui offre un cadre pour l’organisation psychique, mais une force persécutrice, implantée comme une greffe étrangère. L’enfant devient « celui qui doit plaire », «
celui qui ne dit rien », «
celui qui comprend trop bien».
Cette identification produit un
clivage massif du Moi, qui scinde l’appareil psychique en une part soumise, sidérée, et une part pseudo-toute-puissante — le «
nourrisson savant » (wise baby) de Ferenczi — chargée de maintenir l’intégrité imaginaire du Moi (Roussillon, 2016). Ce clivage devient parfois
la condition de la survie psychique, mais laisse l’enfant dans un état d’atomisation subjective (un appareil psychique morcelé, comme dispersé en morceaux), incapable de penser la conflictualité. Il perd son rapport à la réalité, à ses émotions, et à sa propre position de sujet.
La désubjectivation est patente dans le silence de l’enfant, sa passivité ou sa compliance extrême. La désubjectivation, c’est quand une personne ne se sent plus sujet de sa propre vie : elle agit, parle ou ressent sans vraiment se reconnaître dans ce qu’elle vit.
La sidération sensorielle, cognitive et affective constitue l’empreinte traumatique du choc initial. Le sujet cesse de s’éprouver comme tel, « aspiré » dans le fonctionnement de l’autre. Il adopte les mots, les gestes, les justifications de l’agresseur, jusqu’à parfois se croire coupable de ce qu’il a subi.
Sur le plan affectif, cette dynamique donne lieu à une culpabilité toxique, souvent mêlée de honte, et à un retournement pulsionnel vers soi (ou vers autrui). Le corps devient le théâtre d’un conflit intrapsychique pour lequel l’enfant est juste incapable de donner du sens de part son immaturité. Cela donne lieu à des somatisations (asthme, dermatites, douleurs diffuses), à des troubles de l’humeur, ou à une disparition progressive du désir propre. La culpabilité introjectée — celle de l’adulte agresseur — prend une valeur organisatrice. Elle colonise la pensée et empêche toute mise à distance (Duparc, 2011). L’enfant devient « mauvais » à ses propres yeux, parfois au prix de son propre corps.
Cela peut s’exprimer dans des gestes anodins. Par exemple, une petite fille, dont le père est colérique, peut systématiquement vérifier que ses paroles ne le fâchent pas, même à l’école, même avec ses amis. Elle sourit, elle arrange, elle absorbe les conflits des autres, persuadée qu’elle est responsable de l’ambiance autour d’elle. Ce n’est pas de la maturité, c’est le prix de la terreur.
L’enfant reste captif du lien primordial. L’agresseur reste une figure d’attachement. La haine ne peut s’exprimer sans risquer l’effondrement psychique. L’enfant adopte alors une position de soumission muette. Il protège l’agresseur, absorbe ses justifications, et se tait. Le traumatisme est d’autant plus destructeur si l’environnement nie ou invalide cette parole (Zylbermann, 2010).
Le rôle du second parent est ici décisif. Si ce parent se tait, nie ou minimise, l’enfant se retrouve sans recours symbolique. Un recours symbolique, c’est le fait de s’appuyer sur des mots, sur des règles et logiques, des récits ou sur des figures sociales (comme le père, la justice ou le nom) pour donner sens, mettre à distance ou encadrer une expérience intérieure difficile ou une impasse subjective.
Le désaveu, surtout lorsqu’il vient de la mère ou du père protecteur, est vécu comme une trahison. Le lien à l’autre parent est souvent marqué par la confusion, le désaveu ou la trahison. Lorsqu’un parent ne protège pas, minimise, se tait ou nie, il devient lui aussi un objet persécuteur. Ce désaveu — en particulier celui de l’autre parent dans les cas d’abus incestueux ou incestuels — constitue un second trauma, souvent plus pathogène que l’abus lui-même (Press, 2011). La structure familiale devient alors le théâtre d’une perversion systémique, rendant difficile toute parole.
À l’inverse, lorsqu’un adulte nomme la violence, agit (y compris par la séparation d’avec l’agresseur), l’enfant peut commencer à
se dégager psychiquement. La séparation des parents, dans ces cas, peut ne pas être une catastrophe, mais au contraire
une possibilité pour l’enfant de penser autrement.

L’enfant auteur – Rejouer la scène pour se sentir vivant
Certains enfants, identifiés à l’agresseur, rejouent le traumatisme sous une autre forme. Ce n’est pas une imitation consciente, mais une tentative de symboliser ce qui n’a pas pu être pensé. Ils peuvent frapper, blesser, reproduire des gestes déplacés ou des comportements violents. L’école parle d’agressivité, les adultes d’opposition et les moins concernés de « jeux d’enfants ». Mais ce qui est vraiment en jeu, c’est une scène ancienne où la souffrance ne peut que se transmettre, faute d’être dite. Il ne s’agit pas de « passage à l’acte » au sens classique, mais d’une tentative de restitution de la toute-puissance perdue (Chagnon, 2011). Ces conduites peuvent être sexuelles, destructrices, ou simplement désorganisées. Elles expriment une identification projective sur un tiers (frère, camarade, autre parent) qui devient le support d’un retour du trauma, d’une reviviscence ou d’une compulsion de répétition.
Un adolescent de 13 ans décrivait avec froideur des scènes où il frappait des plus jeunes « parce qu’ils m’énervent quand ils sont faibles ». L’entretien révéla qu’il avait été abusé par un cousin adolescent à l’âge de 6 ans, dans un contexte de négligence familiale. La « violence agit » apparaissait comme une tentative de restaurer une image de toute-puissance, construite sur la haine du « faible » qu’il avait été.
Ces actes ne sont pas à punir par le psychothérapeute, mais à interpréter dans un cadre thérapeutique. Ce qui se joue là, c’est le besoin désespéré d’un témoin. Quelqu’un qui ne jugera pas, mais qui pourra mettre des mots là où il n’y avait que des sensations.
L’adulte victime – Rejouer sans savoir, se soumettre en pensant aimer
L’adulte ayant vécu une identification à l’agresseur dans l’enfance peut, des années plus tard, rejouer le même pacte de soumission dans d’autres relations. Il peut s’agir de relations conjugales, professionnelles, amicales, dans lesquelles il ou elle anticipe les attentes de l’autre, minimise voire annihile ses propres besoins, terrorisé(e) à l’idée de poser une limite.
Dans mon article « Clinique de l’emprise en milieu professionnel » (Stroobandt, 2024), j’ai expliqué comment certaines personnes restaient dans des environnements de travail toxiques, non pas par passivité, mais parce qu’elles ne parviennent pas à percevoir le conflit comme légitime. Toute forme de désaccord réactive la peur ancienne d’être rejeté ou puni.
Dans les relations amoureuses, cela peut prendre la forme d’une hypervigilance affective. Une femme, après une dispute, va surveiller son propre téléphone, se demander si elle a été « trop froide », s’empresser de rassurer l’autre… avant même qu’on le lui demande. Ce n’est pas de la dépendance, c’est la réactivation d’une ancienne identification, celle qui disait : « si je deviens ce que l’autre attend, je resterai en vie, en sécurité ».
Le numérique renforce ces logiques. La visibilité constante, la surveillance mutuelle, les notifications lues ou non, deviennent autant de lieux de repli du Moi. L’identification à l’agresseur prend alors une forme moderne, mais toujours aussi silencieuse.
L’adulte auteur – D’une soumission passée à une maîtrise destructrice
Certains adultes ayant été victimes dans l’enfance deviennent auteurs de violences à l’âge adulte. Il ne s’agit pas d’un passage à l’acte par mimétisme, mais d’un
retournement défensif. L’agression devient une façon de ne plus jamais se retrouver impuissant. Dans certains cas, cela s’accompagne d’un
délire de persécution : l’autre est perçu comme une menace, même lorsqu’il ne l’est pas.

Cela émerge aussi dans l’emprise pathologique conjugale. Un homme peut dire : « elle me surveille, elle veut me contrôler », « cette salope me trompe », alors qu’objectivement, il est celui qui exerce une pression constante. Cette projection est le résultat d’un Surmoi implémenté, non intégré, persécuteur, issu de l’enfance. Cela peut aussi être le cas dans l’expression d’une jalousie empreinte de possessivité délirante où l’on vous fait systématiquement des procès d’intention, alors même que l’auteur est celui qui vous trompe.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces adultes agissent pour ne pas sombrer. Ils font subir ce qu’ils ont subi, parfois sans en avoir conscience. Cela ne les déresponsabilise pas, mais cela complexifie l’éthique de l’intervention. La punition seule ne permet pas de désamorcer ce mécanisme. Il faut travailler la scène ancienne, ouvrir un espace où la honte, la rage, la peur peuvent être nommées — sans quoi, elles continueront à s’imprimer dans l’autre.
Trauma ou emprise ? Ce que ce mécanisme n’est pas tout à fait
L’identification à l’agresseur selon Ferenczi est un mécanisme immédiat, effractant, réponse psychique à une situation où la subjectivité est en péril. L’emprise, au contraire, est un processus relationnel, souvent progressif, où le sujet est contraint par un autre à renoncer à sa pensée propre. L’identification à l’agresseur ferenczienne n’implique pas toujours une stratégie de contrôle — elle est une colonisation interne, subie, dont les effets peuvent devenir structurels (« permanent »).
Toutefois, ces deux logiques peuvent s’articuler. L’identification à l’agresseur peut préparer le terrain à une emprise durable, en inhibant les capacités de jugement et en entretenant une loyauté à l’agresseur, et par le retournement défensif. Dans des cas de « folie à deux », ou de violences transgénérationnelles, la confusion entre intérieur et extérieur s’amplifie jusqu’à devenir structurelle (Vandermersch, 2018), cristallisé, durable, irréversible pour les protagonistes eux-mêmes. La victime s’identifie à l’agresseur parce qu’elle est sous emprise, et cette identification renforce l’emprise. C’est un cercle vicieux.
Comment aider ? Soutenir sans casser, tenir sans dominer
L’intervention psychothérapeutique suppose de ne pas répéter la logique d’écrasement.
Pour qu’un enfant ou l’adulte sorte de cette spirale, il faut lui offrir un cadre stable, où il n’a pas à choisir entre trahir ou se taire. Le praticien doit être capable d’entendre sans brusquer, de résister à l’envie de consoler trop vite ou d’expliquer trop tôt. C’est dans ce lien nouveau, fiable et non intrusif que le patient pourra peu à peu faire émerger sa propre voix (Pariset, 2009).
Le travail contre-transférentiel (la réponse du praticien) est intense : « Je suis parfois sommé de « me taire comme les autres », ou mis à l’épreuve dans des zones de toute-puissance. Mon patient se pense plus expert que je ne peux l’être ».
Le premier enjeu est de reconnaître la logique de survie qui a présidé à cette identification. Il s’agit de désamorcer l’agresseur « implanté », sans le rejeter brutalement. Cela suppose de tenir la complexité du lien traumatique sans rabattre le/la patient(e) sur une posture de victime :
« Je dois être capable de supporter, d’endurer - je ne dois ni m’identifier à l’agresseur, ni prendre la place du « sauveur », mais permettre à mon patient d’émerger hors de ce paradoxe ».
L’enjeu est d’inviter progressivement le patient à récupérer sa capacité d’agir et de penser.
« Je dois reconnaître l’agresseur implanté dans la psyché de ma patiente, puis progressivement lui communiquer cette compréhension. Dans certaines situations, cela peut prendre des années tellement retirer l’implant mets en danger la cohérence structurelle de ma patiente. »
Il s’agit d’accompagner mon patient à distinguer ce qui vient de lui et ce qui a été imposé, à retrouver ses émotions, ses pensées, et des relations plus « saines ».
Le travail est long, parfois chaotique, mais possible.
Le cadre doit être suffisamment contenant pour accueillir les « agirs », les silences et les identifications.
Introduire le tiers est essentiel, c’est-à-dire l’introduction d’une altérité stable qui permet la différenciation. Elle peut passer par l’instance judiciaire, l’entourage, mais surtout par la constance du cadre thérapeutique.
Les dispositifs familiaux ou de réseaux sont essentiels, notamment pour déconstruire les alliances implicites et les fantasmes de loyauté toxique.
Conclusion — Sortir du ventre d’Hadès : de la survie silencieuse à la parole retrouvée
Comprendre l’identification à l’agresseur selon Ferenczi, c’est
s’approcher d’un noyau de feu, à la fois ancien et actuel. Ce que l’enfant fait pour ne pas mourir —
s’effacer, se fondre, porter la faute de l’autre — laisse une marque longue, qui parfois s’infiltre dans la vie adulte, dans
la manière de s’attacher ou pas, de s’excuser ou pas, de se taire ou pas. C’est une dynamique psychique
qui ne se voit pas toujours, mais qui travaille en souterrain, comme un volcan qui sommeille.

Dans cette logique, nous ne choisissons pas. Nous obéissons à une mémoire traumatique. Nous reproduisons, parfois sans le vouloir, la scène originaire. Nous nous attachons à ce qui détruit, parce que cela a été, un jour, l’unique façon de rester lié à l’Autre — même défiguré.
Ferenczi nous a transmis cette scène primitive de l’emprise. Anna Freud, que nous verrons dans un autre article, tentera d’en penser le versant défensif. Le syndrome de Stockholm, plus tard, mettra en lumière l’étrange alchimie entre menace et gratitude.
Mais ici, dans l’ombre de l’agresseur intériorisé, il est une figure de la mythologie grecque qui peut éclairer notre réflexion : Perséphone, enlevée par Hadès, roi des Enfers, contrainte de vivre dans l’obscurité une partie de l’année. Perséphone ne revient pas indemne. Elle revient transformée. Elle est désormais entre deux mondes, porteuse de mort et de renaissance.
De la même façon, sortir d’une identification à l’agresseur, c’est remonter lentement des Enfers, ramener avec soi une connaissance, une parole, une possibilité de recommencement. C’est accepter que la lumière ne soit jamais totale, que les cicatrices parlent, mais que rien n’est figé. C’est aussi, parfois, comprendre que la séparation — du parent destructeur, du partenaire dominateur, du silence familial, de l’ignorance sociale — n’est pas une fuite, mais une mise à distance salvatrice.
Et c’est là que commence le travail psychothérapeutique :
transformer l’obéissance en responsabilité, la fusion en différenciation, la répétition en narration.
Bibliographie
Bertrand, M. (2009). L’identification à l’agresseur chez Ferenczi : masochisme, narcissisme. Revue française de psychanalyse, 73(1), 11–20.
Bourdellon, G. (2009). Violence du déni et identification à l’agresseur chez l’enfant. Revue française de psychanalyse, 73(1), 21–35.
Chagnon, J.-Y. (2011). Identification à l’agresseur et identification projective à l’adolescence. Topique, 115, 127-140.
Duparc, F. (2011). La rage, la honte et la culpabilité aux origines du malaise dans la culture. Revue française de psychosomatique, 39, 1759-1768.
Ferenczi, S. (1932/2023). Confusion de langues entre les adultes et l’enfant. Paris : Payot.
Pariset, O. (2009). Identification à l’agresseur et travail de contre-transfert. Revue française de psychanalyse, 73(1), 109-122.
Press, J. (2005). Un concept crucial : l’identification à l’agresseur. Le Coq-Héron, 181, 85–92.
Stroobandt, T. (2024). Clinique de l’emprise en milieu professionnel : du silence au symptôme collectif.
Zylbermann, D. (2010). Familles maltraitantes, identification à l’agresseur. Les Lettres de la S.P.F., 24, 89–98.
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Tous les articles