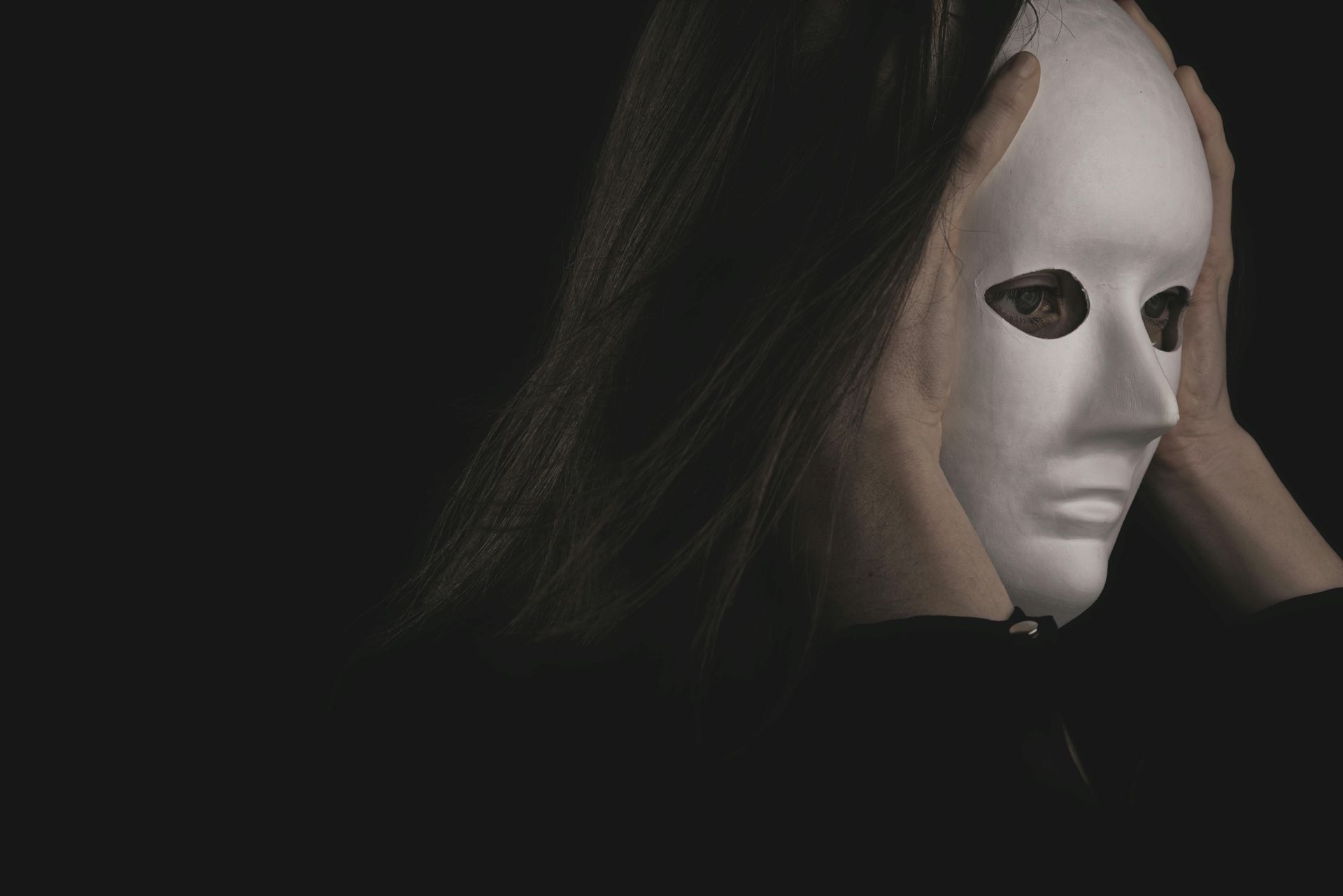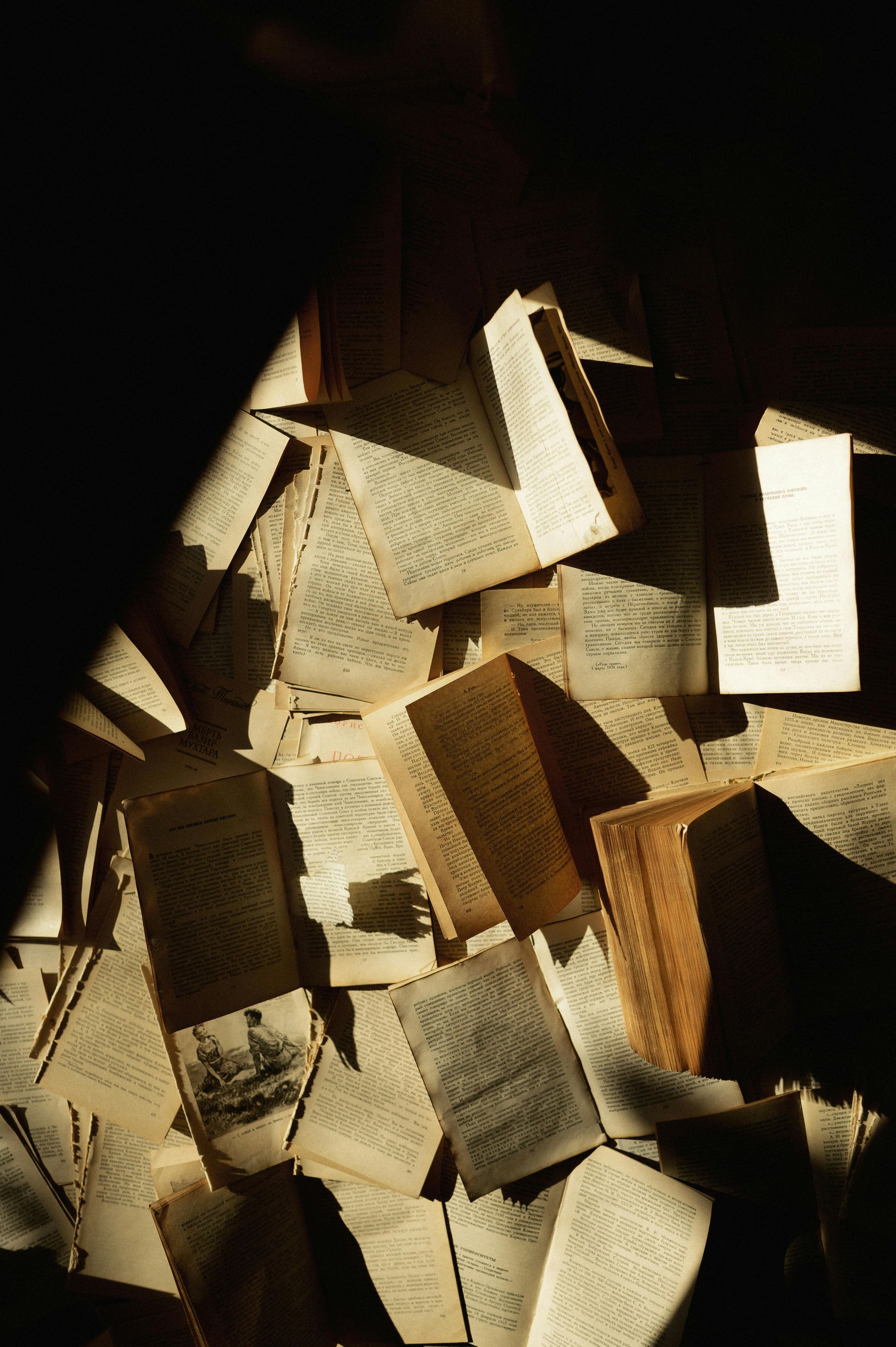Supervision en milieu associatif : Faire tiers, faire lien, faire sens
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Tenir quand plus rien ne tient :
la supervision comme geste clinique et politique
Dans certains contextes associatifs, ce qui vacille n’est pas seulement une organisation ou une équipe. C’est une position subjective, une éthique du soin, un rapport au monde. Là où l’idéal humaniste entre en collision avec les failles réelles du collectif, la supervision s’impose non comme un outil de régulation, mais comme un lieu de subjectivation face au vacillement institutionnel.
Ce vacillement peut être sourd ou criant. Il prend la forme d’une équipe qui se replie, d’un conflit qui dégénère, d’un projet qui échoue sans qu’on sache pourquoi. Mais parfois, il s’impose comme une onde de choc : une révélation d’abus, une trahison de la mission initiale, une atteinte symbolique majeure. Dans ces moments-là, l’institution ne joue plus son rôle de tiers protecteur. Et l’équipe, souvent sans mots, devient le symptôme de cette défaillance.

Superviser dans ces espaces revient à soutenir une traversée du réel. Non pour apaiser à tout prix, mais pour permettre à la parole de se déposer là où elle ne circulait plus. Cet article propose une lecture incarnée et critique de la supervision associative, en distinguant trois entrées cliniques principales : la supervision de cas, la supervision des dynamiques collectives, et celle des conflits ou traumatismes organisationnels.
Accompagner un cas,
c’est entendre ce que la situation réveille chez celui qui l’accompagne
Les demandes de supervision clinique émanent souvent de professionnels confrontés à une situation jugée « difficile » : une adolescente mutique placée en urgence, un jeune migrant oscillant entre agressivité et effondrement, une famille dont les appels à l’aide deviennent intrusifs. Pourtant, ce n’est pas la complexité objective de la situation qui déclenche la demande, mais bien l’impossibilité subjective de continuer sans s’abîmer.
La supervision ne vise pas ici à « résoudre » un problème, ni à offrir un mode d’emploi. Elle permet de mettre en mots l’implication subjective du professionnel : ce que cette situation ravive en lui, ce qui l’épuise, ce qui l’empêche de penser. Il ne s’agit pas de pathologiser le lien, mais de le rendre à nouveau symbolisable (Kaës, 2009). Le travail consiste à entendre ce qui se joue dans le transfert, ce qui résiste dans le contre-transfert, et ce que l’institution autorise ou pas dans l’élaboration.
En supervision, je m’efforce d’offrir un cadre suffisamment contenant pour que la souffrance puisse être déplacée sans être évacuée. La supervision devient alors un espace tiers (Winnicott, 1971) : ni soin, ni management, mais un lieu de parole soutenue, libre, éthiquement tenue.
Quand le groupe se délite :
penser l’échec des projets comme symptôme collectif
Dans de nombreuses équipes associatives, ce ne sont pas les cas individuels qui épuisent le plus, mais les projets collectifs qui ne prennent pas. Un atelier lancé avec enthousiasme s’effondre au bout de trois séances. Un groupe d’adolescents s’auto-détruit après une période prometteuse. Une dynamique de co-construction se transforme en rivalité stérile.
Ces « ratés » ne sont pas anecdotiques. Ils disent souvent l’absence d’un cadre symbolique suffisant, ou l’actualisation d’un clivage institutionnel sous-jacent. Dans ce type de supervision, nous interrogeons ce qui dans le collectif empêche l’activité d’advenir comme lieu de lien (Anzieu, 1975). Il ne s’agit pas d’analyser les « erreurs » de pilotage, mais de penser ce qui empêche le groupe de se constituer comme sujet.
On y mobilise des repères issus de la clinique du groupe : le fantasme du groupe idéal, la peur du chaos, les alliances inconscientes (Kaës, 2012), les figures d’identification conflictuelles. Mais on y travaille aussi des éléments plus institutionnels : qui est garant du cadre ? Quelles places sont données ou refusées ? Quel rythme est imposé, et à qui ?
Superviser un projet, c’est souvent entendre ce que son échec rejoue d’un impensé plus vaste. C’est
réintroduire du tiers symbolisant là où la dynamique groupale est prise dans un court-circuit pulsionnel ou défensif.

Quand l’institution devient le problème :
supervision des conflits et traumatismes collectifs
Certaines demandes de supervision sont formulées sous la forme classique d’un conflit d’équipe : tensions entre collègues, rivalités entre directions, sentiments d’injustice ou de surcharge. Mais à l’écoute, il apparaît que ce qui se joue excède le simple différend relationnel. L’équipe devient le lieu de dépôt d’un malaise structurel. Le conflit est souvent la forme visible d’une défaillance symbolique en amont.
Je me souviens de cette supervision engagée à la suite de la révélation d’abus sexuels commis par le président d’une ASBL sur plusieurs stagiaires et employées. Toute l’équipe était sidérée. Mais derrière la sidération, il y avait une question plus vaste : comment avons-nous pu ne pas voir ? Qui savait ? Qui a couvert ? L’équipe n’était pas seulement traumatisée par les faits — elle était désorientée, culpabilisée, réduite au silence par le poids et la honte.
On entre alors dans ce que certains appellent le traumatisme organisationnel (Barbier, 2006 ; Desmazières, 2022) : lorsque l’institution, censée garantir la sécurité, devient elle-même la source de l’effraction. Ce traumatisme n’est pas seulement psychique : il est symbolique, politique, collectif. Il atteint le noyau même de la mission, du cadre, de la possibilité de continuer à faire équipe.
Dans ces cas, la supervision ne peut pas rester à l’échelle de la régulation. Il faut reconstruire un socle commun, un espace où la parole puisse exister sans danger, sans honte, sans surmoi organisationnel.
J’y mobilise une posture très tenue : écoute sans intrusion, rappel du cadre, reconnaissance des effets collectifs du trauma. Le but n’est pas de “réparer” l’équipe, mais de rendre pensable ce qui semblait indicible, pour que chacun puisse retrouver sa place — ou parfois en décider autrement.
Une posture clinique, pas une fonction réparatrice
Dans les trois formes décrites — clinique individuelle, dynamique collective, crise institutionnelle — la supervision associative ne peut être confondue avec une fonction d’ajustement ou de pacification. Elle est une pratique du tiers. Un travail de reprise, de mise en tension, de relance symbolique. Elle ne vise pas l’harmonie, mais l’élucidation des conflits, des résistances, des fantasmes d’idéalisation ou d’abandon.
Ma posture n’est ni neutre, ni omnisciente. Elle est clinique. Cela veut dire : impliquée, mais décentrée. Capable d’accueillir le sujet dans ce qu’il vit, sans l’absorber. Capable de parler de l’institution sans s’y fondre. Capable de soutenir le Réel, sans le recouvrir trop vite de solutions managériales.
Cette supervision n’est pas confortable. Elle ne cherche pas à rassurer. Mais elle permet souvent, en bout de course, que quelque chose se réorganise symboliquement — dans la place, dans la parole, dans la capacité d’agir.

Conclusion : Superviser pour que la parole ne soit pas broyée
Superviser en milieu associatif, c’est refuser que les professionnels s’effondrent dans le silence ou la suradaptation. C’est créer des lieux où l’on peut dire : ce que je vis est trop, je ne sais plus quoi faire, je me sens seul, j’ai honte, je suis en colère. Ce n’est pas du déballage émotionnel. C’est du travail symbolique. Et dans les institutions les plus fragiles, c’est parfois le dernier rempart contre la déshumanisation.
C’est parce que le Réel déborde, parce que l’idéal s’effondre, parce que la Loi vacille, que la supervision peut devenir un lieu essentiel — pas pour réparer, mais pour reprendre langue avec ce qui semblait perdu.
Bibliographie
Anzieu, D. (1975). Le groupe et l’inconscient. Dunod.
Barbier, J.-M. (2006). Le traumatisme organisationnel. Érès.
Desmazières, A. (2022). Les traumatismes collectifs en institution. Champ Social.
Kaës, R. (2009). Le lien d’alliance en psychanalyse. Dunod.
Kaës, R. (2012). Les alliances inconscientes. Dunod.
Stroobandt, T. (2024). Clinique de l’emprise en milieu professionnel : du silence au symptôme collectif.
Winnicott, D. W. (1971). Jeu et réalité. Gallimard.



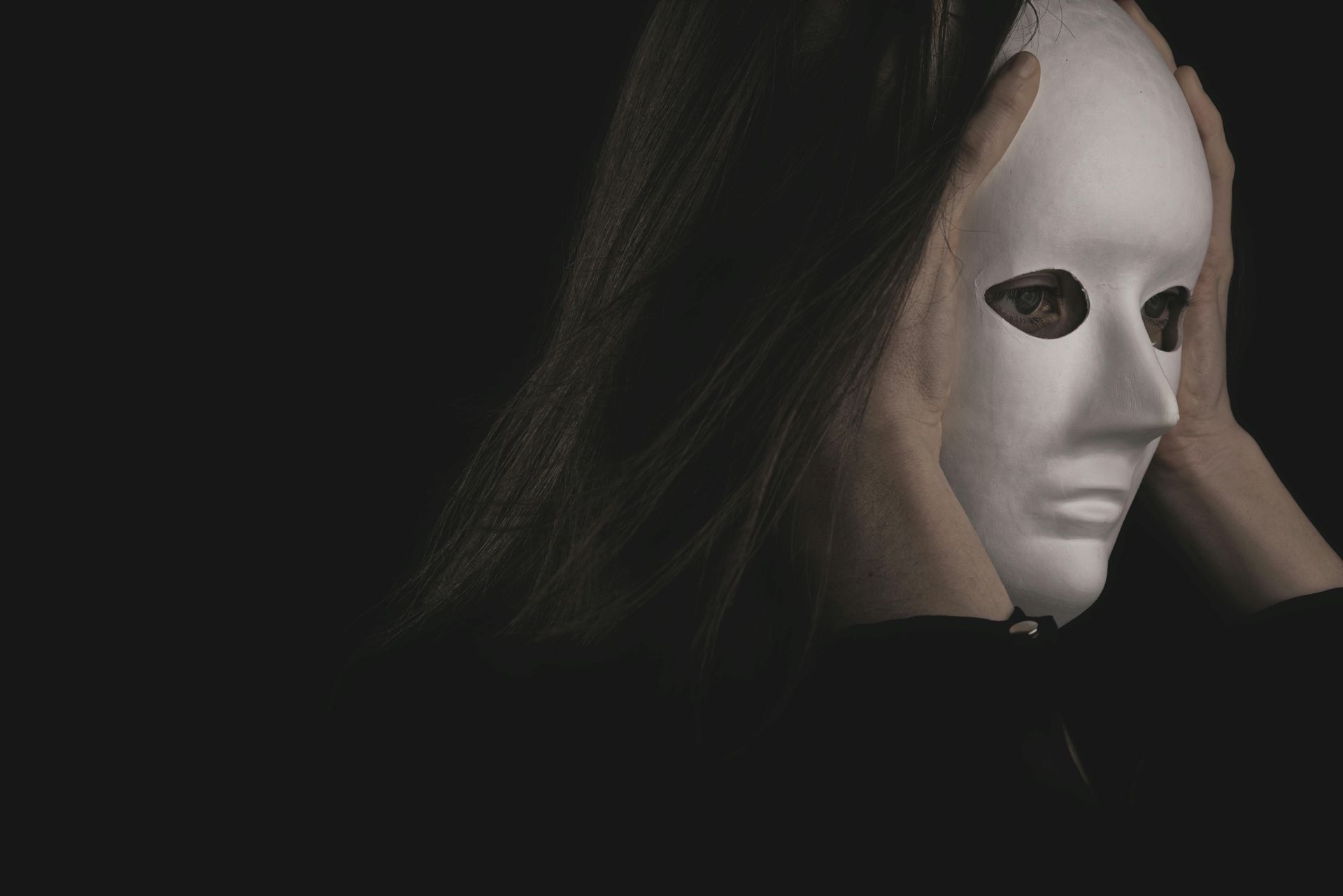

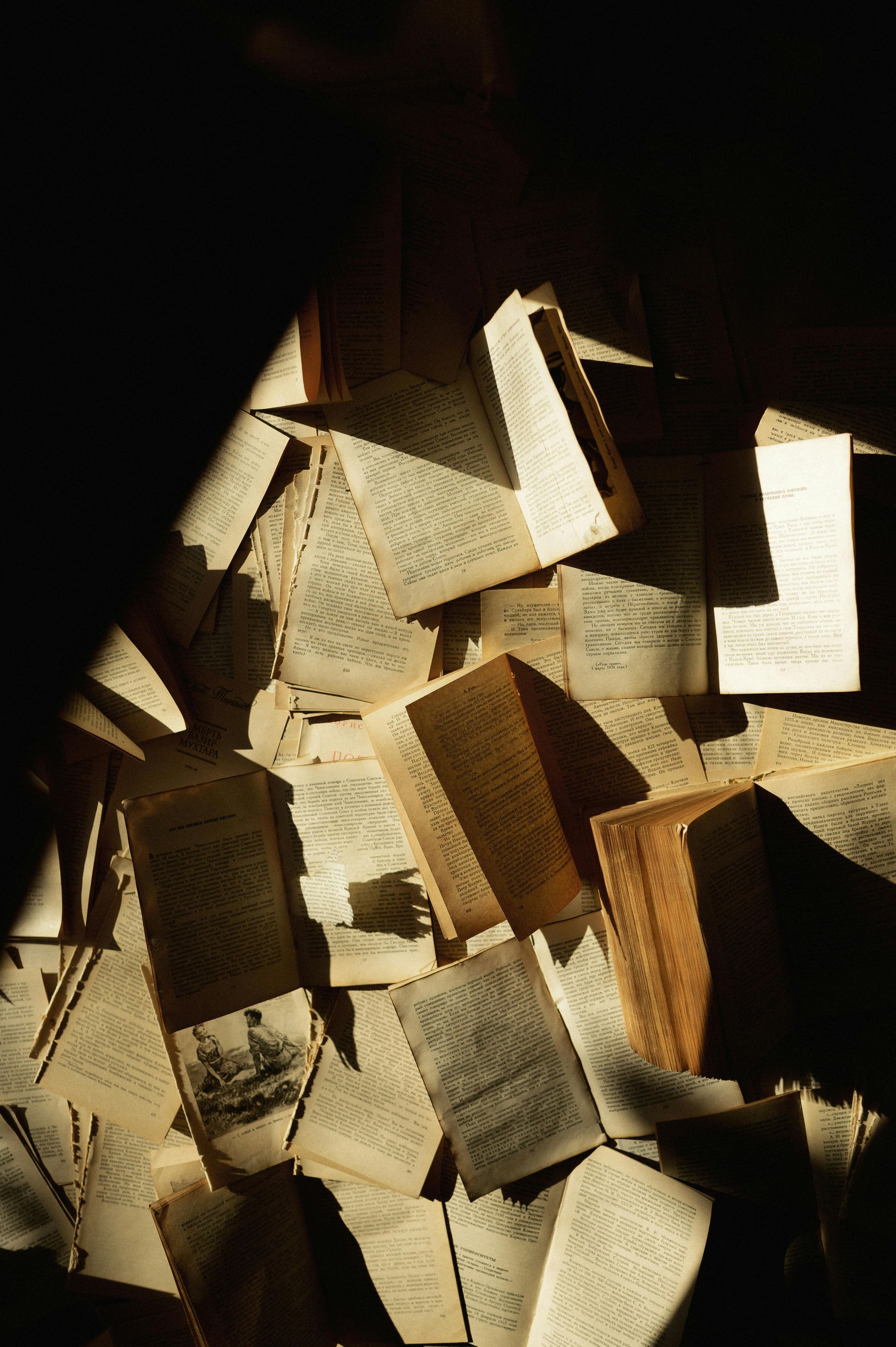



Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Tous les articles