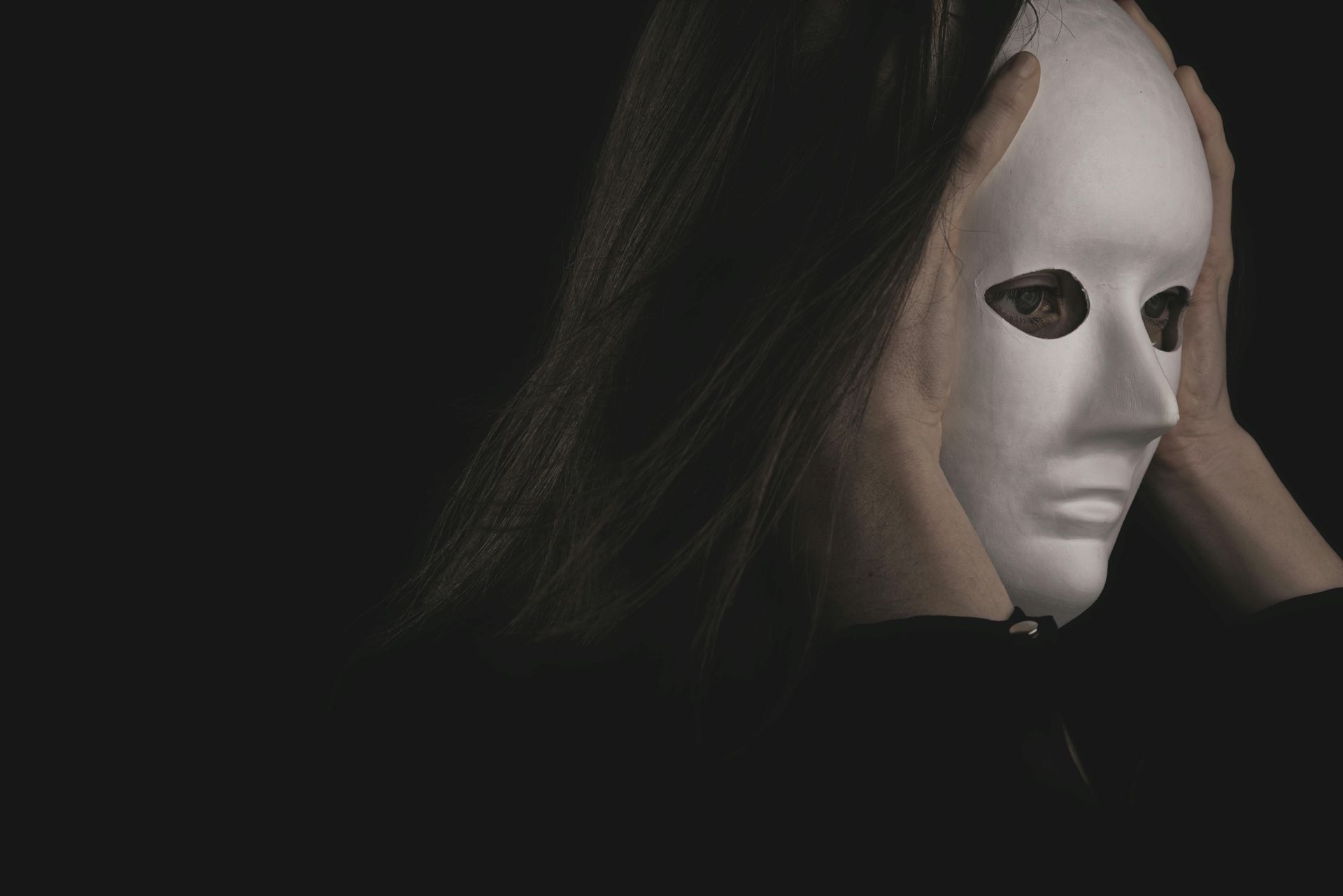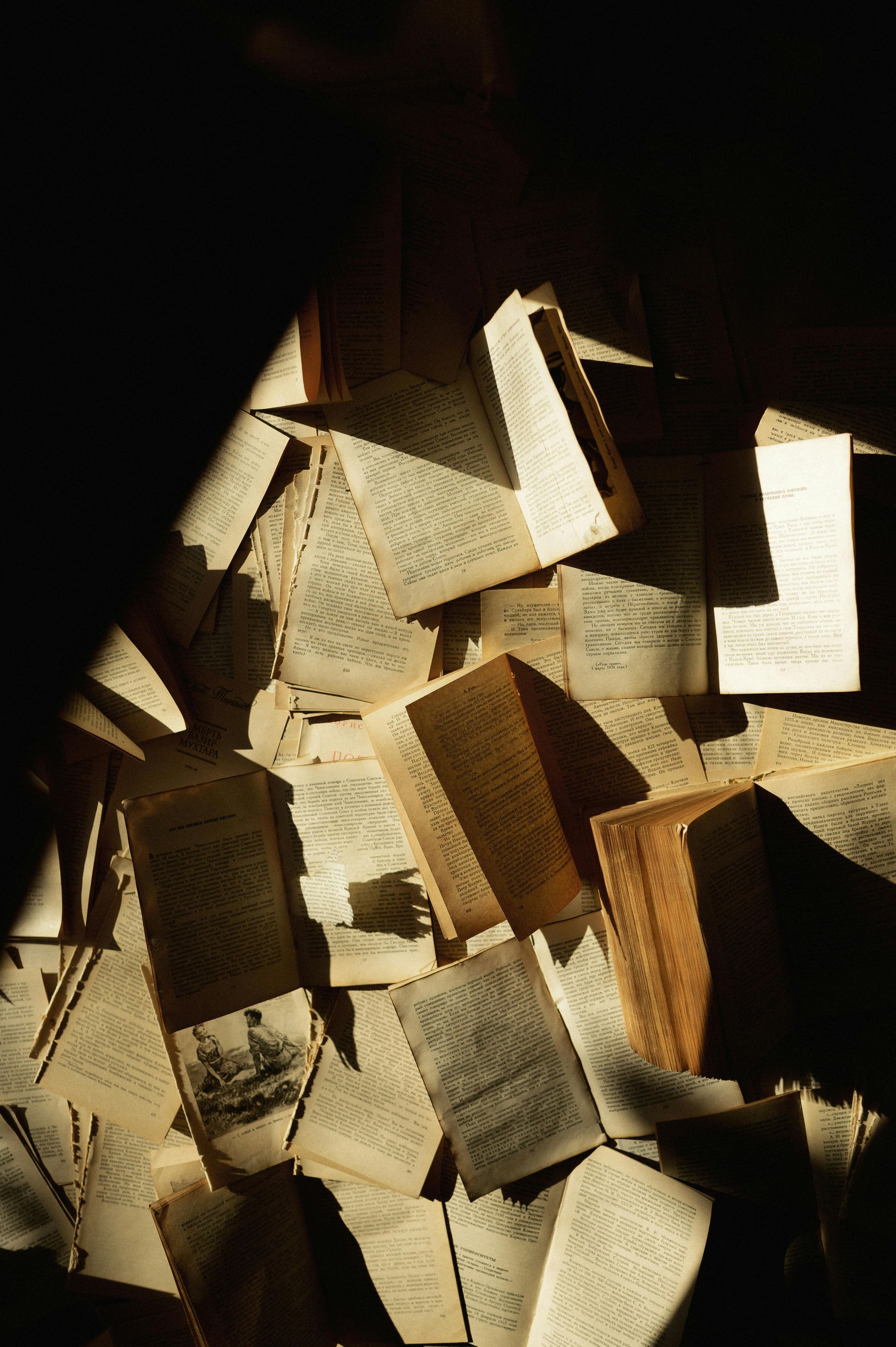Tenir la parole dans l’intime : la supervision des praticiens
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Quand on accompagne les autres, qui nous accompagne ?
Dans le flux permanent des consultations, au milieu des agendas surchargés et des responsabilités multiples, une question demeure souvent en suspens : qui prend soin de celui qui prend soin ? Qui écoute celui qui écoute ? La supervision individuelle ne répond pas à cette question par un protocole, mais par une présence, un cadre, un engagement. Elle offre un lieu pour penser ce qui traverse le praticien, sans jugement ni recette, mais avec rigueur et exigence.
Superviser, ce n’est pas “corriger” une pratique ou faire passer un examen de compétence. C’est
permettre au sujet qui exerce un métier de l’humain de reprendre langue avec son désir, ses limites, ses zones d’ombre, ses convictions. C’est refuser que la clinique se résume à une application de grilles ou de normes. C’est remettre de l’humain là où la fonction tend à éteindre la parole. À rebours des injonctions à l’efficacité et à la maîtrise, la supervision défend l’idée que le trouble n’est pas un défaut, mais un indicateur précieux — à condition d’en faire quelque chose.

La supervision comme lieu tiers : entre pratique, subjectivité et institution
Lorsqu’un professionnel s’engage en supervision, ce n’est jamais anodin. Quelque chose ne tient plus comme avant. Ce peut être une situation difficile, une résonance personnelle, une fatigue chronique, un conflit institutionnel, ou un malaise diffus. Mais au fond, la demande véritable porte souvent sur la place même du professionnel dans ce qu’il fait. Pas seulement “comment faire”, mais “qui je suis là-dedans ?”, “qu’est-ce que cela me fait ?”, “qu’est-ce que je ne supporte plus ?".
La supervision devient alors un espace tiers (Winnicott, 1971), situé entre l’intimité du praticien et les exigences de la fonction. Elle permet de penser l’écart — ou parfois la confusion — entre la subjectivité et le rôle. Elle aide à mettre au travail ce qui agit dans le transfert et le contre-transfert, même en dehors des cadres psychanalytiques stricts. Comme l’écrit Roussillon (2008), « le professionnel est pris dans des processus psychiques inconscients qu’il doit apprendre à élaborer pour ne pas en être prisonnier. »
Quand le symptôme se déplace : ce n’est pas l’usager qui pose problème
Il est courant qu’un praticien vienne en supervision pour parler d’un cas “particulier”. Un jeune qui déclenche sa colère. Une patiente qui s’attache trop. Un parent qui envahit. À mesure que la parole se déploie, ce qui émerge, ce n’est pas seulement la complexité de l’autre. C’est ce que cette relation vient toucher d’inédit ou d’inquiétant chez le professionnel lui-même.
La supervision ne vise pas ici à “gérer” la situation, mais à entendre ce qui se rejoue dans le lien. Il ne s’agit pas de suspecter un trauma caché, mais de reconnaître que toute pratique implique une part d’inconscient. Que le sujet professionnel n’est jamais neutre. Que le symptôme peut être institutionnel, relationnel ou subjectif — et qu’il mérite d’être accueilli dans sa pluralité (Kaës, 2009).
Dans certains cas, le malaise provient moins du lien à l’usager que de l’écart entre les valeurs du praticien et les exigences institutionnelles. La supervision permet alors de penser la tension éthique, de mettre en mots ce qui pourrait sinon devenir un épuisement silencieux, une fuite, ou un passage à l’acte.
Nommer les impasses, tenir les limites, penser le cadre
Un des effets fréquents de la supervision est de permettre la relecture du cadre professionnel, non comme un ensemble de règles, mais comme un lieu symbolique à investir. Beaucoup de praticiens vivent des difficultés à poser ou tenir leurs limites : peur d’être trop rigides, d’être rejetés, ou au contraire de s’effondrer sous la demande.
Ce n’est pas un manque de compétence, mais souvent un conflit intérieur autour de la position d’autorité symbolique (Lévy, 2015). Dans l’espace supervisé, nous travaillons alors ce que signifie “tenir un cadre” : non pas pour protéger l’institution, mais pour permettre au lien d’être transformateur sans être destructeur. Pour que la parole reste possible sans débordement, ni fusion, ni abandon.
Tenir un cadre, ce n’est pas s’endurcir. C’est
penser l’espace de la relation comme un espace symbolique, avec ses limites, ses lois, ses risques. C’est assumer qu’il n’y a pas de lien sans tension, pas de fonction sans responsabilité, pas de soin sans renoncement.

Début de carrière, vertige du réel : accompagner les premières secousses
De nombreux jeunes professionnels arrivent en supervision peu après leur entrée dans le métier. Ils ont été formés à repérer des troubles, à appliquer des méthodes, à mobiliser des outils. Mais rien ne les a préparés à la sidération de l’impuissance, à la répétition traumatique, ou à la violence feutrée des institutions.
Ils s’inquiètent de mal faire, de ne pas assez aider, de ne plus savoir quoi dire. Ils ne manquent pas de savoir-faire. Ils manquent souvent d’un lieu pour nommer ce que le réel produit en eux. La supervision devient alors un espace d’apprentissage du métier par le doute, et non par la seule validation. Elle offre une éthique du “je ne sais pas”, qui n’est ni une faille ni une faiblesse, mais un point de départ.
Cifali (2007) parle de la fonction d’humanité dans les métiers de l’humain. Elle ne s’apprend pas dans les livres. Elle se tisse dans la confrontation avec la réalité, dans la parole partagée, dans la reprise symbolique de ce qui déborde.
Conclusion : Superviser, c’est refuser que le praticien se taise
La supervision individuelle n’a pas pour but de produire des praticiens idéaux. Elle ne vise pas l’optimisation des pratiques ni la réduction du risque. Elle cherche à préserver un espace où le sujet puisse continuer à se penser dans ce qu’il fait, à ne pas s’effacer derrière son rôle.
Dans un monde professionnel qui valorise l’adaptation, la fluidité et l’effacement du doute, superviser, c’est résister à la désubjectivation. C’est soutenir une posture habitée, consciente, parfois hésitante, mais vivante. Une posture qui n’a pas peur de reconnaître ses limites, ses résonances, ses impasses. Une posture éthique au sens fort : qui ne prétend pas tout maîtriser, mais qui choisit de tenir — de rester là, présent, avec l’autre, même quand c’est difficile.
Bibliographie
Cifali, M. (2007). La fonction d’humanité dans les métiers de l’humain. PUF.
Kaës, R. (2009). Le lien d’alliance en psychanalyse. Dunod.
Lévy, A. (2015). L’autorité dans le soin. Erès.
Roussillon, R. (2008). Le travail de l’inconscient dans les institutions. PUF.
Stroobandt, T. (2024). Clinique de l’emprise en milieu professionnel : du silence au symptôme collectif.
Winnicott, D. W. (1971). Jeu et réalité. Gallimard.



Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Tous les articles