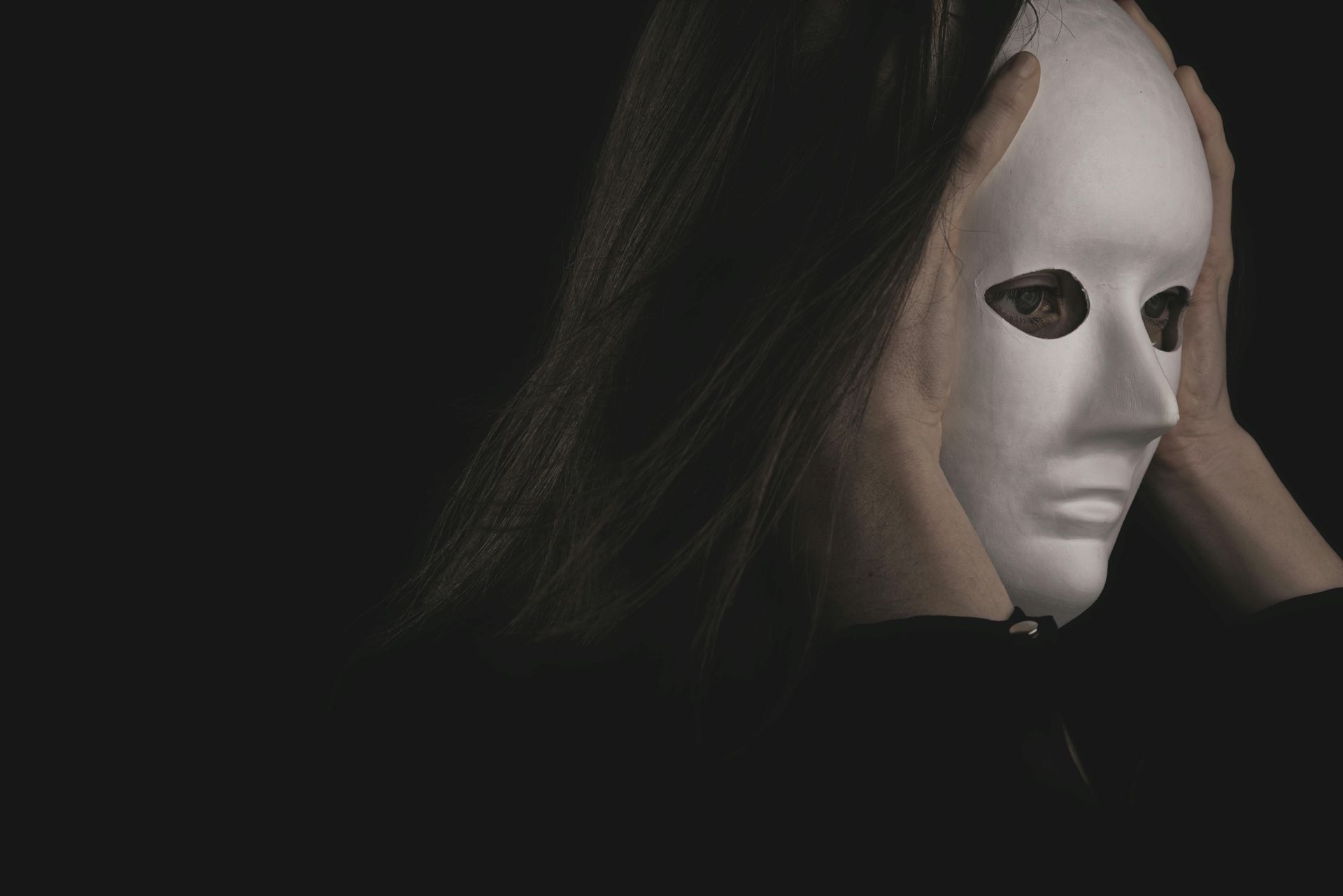Supervision : affiner sa clinique face au trauma et à l’emprise
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Quand le doute ne vient plus, le danger commence
J’ai souvent plus confiance dans un professionnel qui doute que dans un professionnel sûr de lui. Non pas par goût de l’indécision, mais parce que le doute clinique est une éthique : il signale une attention, une inquiétude pour l’autre, et surtout une capacité à se laisser traverser sans se perdre.
Mais certains doutes sont vertigineux. Ils surgissent quand la parole de l’autre nous percute au-delà du rôle, quand le trauma entre dans la pièce sans frapper, ou quand la dynamique d’emprise s’installe sans qu’on ait vu le piège se refermer. Dans ces moments, la supervision individuelle ne relève pas du luxe, mais d’un espace vital de subjectivation.
Ce texte n’a pas pour but de décrire la supervision comme un outil de progression professionnelle. Il s’agit ici de témoigner de ce qu’elle permet, quand elle est tenue comme espace éthique, en particulier face à des situations marquées par le trauma, la répétition, ou l’ambivalence relationnelle.
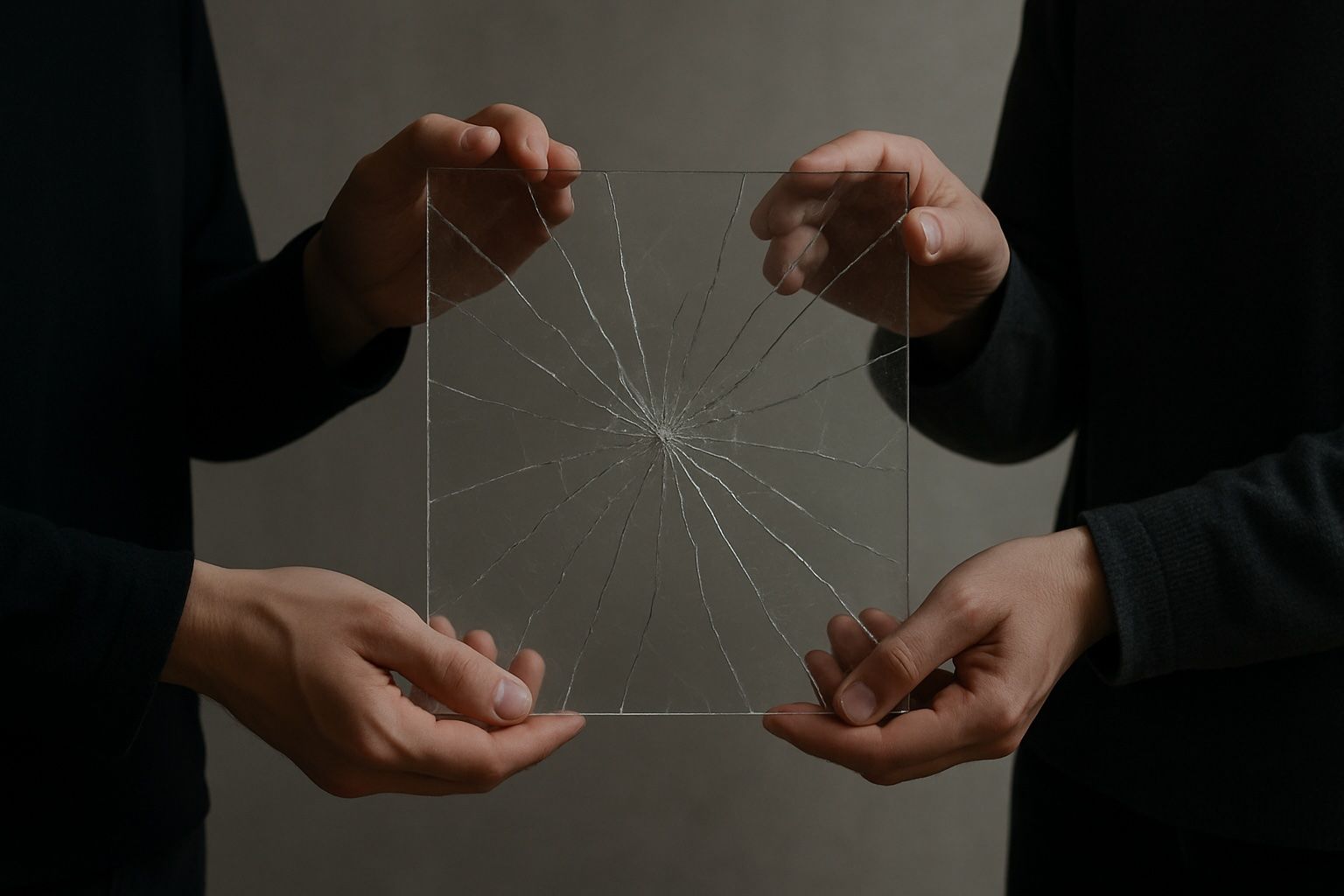
Quand la clinique vacille sous le poids du transfert traumatique
Un praticien peut tenir des années dans un cadre stable, jusqu’au jour où une situation ravive un point non symbolisé : le récit d’un inceste qui résonne trop près, une patiente qui s’effondre comme une sœur disparue, un jeune qui vous insulte comme un père l’a fait. Ce n’est pas une faiblesse. C’est la part humaine du métier. Mais sans lieu pour déposer ce vécu, le praticien s’expose à l’effondrement ou à la suradaptation.
Le trauma a ceci de particulier qu’il court-circuite les repères symboliques, qu’il produit des effets sans toujours passer par la pensée. La supervision devient alors un lieu de reprise, où ce qui n’a pas pu se dire dans l’instant peut être mis en récit, sans danger, sans honte, sans obligation de performance.
Il ne s’agit pas de faire une thérapie du praticien, mais de soutenir sa capacité à penser ce qu’il traverse, pour qu’il puisse à nouveau accompagner sans se confondre, sans se défendre, sans se dissocier (Roussillon, 2008 ; Cifali, 2007).
L’emprise ne prévient pas : elle s’installe dans le lien, en douceur
L’un des angles morts de la clinique contemporaine, c’est la difficulté à penser l’emprise quand elle se glisse dans la relation d’aide elle-même. Un praticien peut être pris dans une dynamique où le lien devient captation, la loyauté, reddition, la présence, empiètement. Ce n’est pas parce qu’on est professionnel qu’on est protégé. L’effet d’emprise est parfois plus difficile à repérer quand il se joue sous couvert de vulnérabilité, dans une relation marquée par la pitié, le sauvetage, ou la peur d’abandonner.
En supervision, j’ai accompagné des praticiens qui ne pouvaient plus poser de cadre, de peur de “faire violence”. D’autres qui se retrouvaient progressivement vidés, parce qu’ils s’étaient mis à répondre à des appels en dehors des séances, à accepter des mails nocturnes, à se justifier sans fin. Dans ces cas, la perte de position clinique est insidieuse : elle ne se repère qu’en creux, dans l’épuisement, dans la perte de désir, dans le sentiment de ne plus savoir ce qu’on fait là.
La supervision permet de désamorcer l’effet hypnotique de l’emprise. De remettre du langage là où la confusion a tout envahi. De redonner au praticien sa place symbolique, non pas au-dessus, mais à distance suffisante pour entendre, sans être happé.
Sortir du silence professionnel : la parole comme boussole clinique
Le plus grand danger dans la clinique du trauma et de l’emprise, ce n’est pas l’intensité émotionnelle. C’est le silence. Le silence institutionnel, le silence entre collègues, mais surtout le silence intérieur du praticien qui ne sait plus à qui dire ce qu’il vit. Qui a peur d’être jugé, disqualifié, vu comme "pas assez solide".
Or c’est précisément quand la honte s’installe dans la pratique que les erreurs deviennent dangereuses. Pas les erreurs techniques : les erreurs éthiques. Celles où l’on se suradapte, où l’on se retire, où l’on fait à la place, où l’on accepte l’inacceptable par fatigue ou loyauté inconsciente.
La supervision est alors un
lieu de désenclavement, où l’on peut dire sans devoir prouver, raconter sans devoir se défendre. Elle devient un
espace de symbolisation partagée, un lieu où
le langage reprend ses droits sur ce que l’effroi avait figé (Kaës, 2009).

Superviser, c’est soutenir une éthique de la place
Je ne crois pas à une supervision neutre. Je crois à une supervision située, clinique, impliquée, qui ne confond pas la parole avec l’analyse, ni la posture avec la solution. Dans ce travail, je cherche moins à guider qu’à tenir un espace de mise en tension, de relance, de reprise.
Ce que je repère chez de nombreux professionnels, c’est une confusion entre écoute et fusion, entre empathie et identification, entre soutien et sauvetage. La supervision permet de remettre des distinctions symboliques là où le trauma ou l’emprise ont tout nivelé. Elle aide à retrouver une position clinique qui ne s’épuise pas à vouloir tout porter, ni ne se protège dans l’indifférence.
C’est un travail exigeant, souvent inconfortable. Mais il ouvre des voies :
vers une pratique habitée, moins défensive, plus libre. Pas parfaite. Mais juste. Et surtout : vivante.
Conclusion : Tenir bon, ce n’est pas tenir seul
Face à l’emprise, face au trauma, le praticien n’a pas à être héroïque. Il a à être accompagné. Non parce qu’il serait défaillant, mais parce que personne ne peut tenir la complexité du réel sans relais.
Superviser, ce n’est pas évaluer. C’est tenir une parole là où le silence menace, remettre du sens là où le vécu déborde, soutenir une fonction symbolique là où le lien est devenu fusion ou désespoir.
C’est un acte éthique, radicalement humain. Un pari que la parole, même fracturée, peut encore faire tiers, encore faire limite, encore faire soin.
Bibliographie
Cifali, M. (2007). La fonction d’humanité dans les métiers de l’humain. PUF.
Kaës, R. (2009). Le lien d’alliance en psychanalyse. Dunod.
Lévy, A. (2015). L’autorité dans le soin. Erès.
Roussillon, R. (2008). Le travail de l’inconscient dans les institutions. PUF.
Stroobandt, T. (2025). Clinique de l’emprise en milieu professionnel : du silence au symptôme collectif.
Winnicott, D. W. (1971). Jeu et réalité. Gallimard.



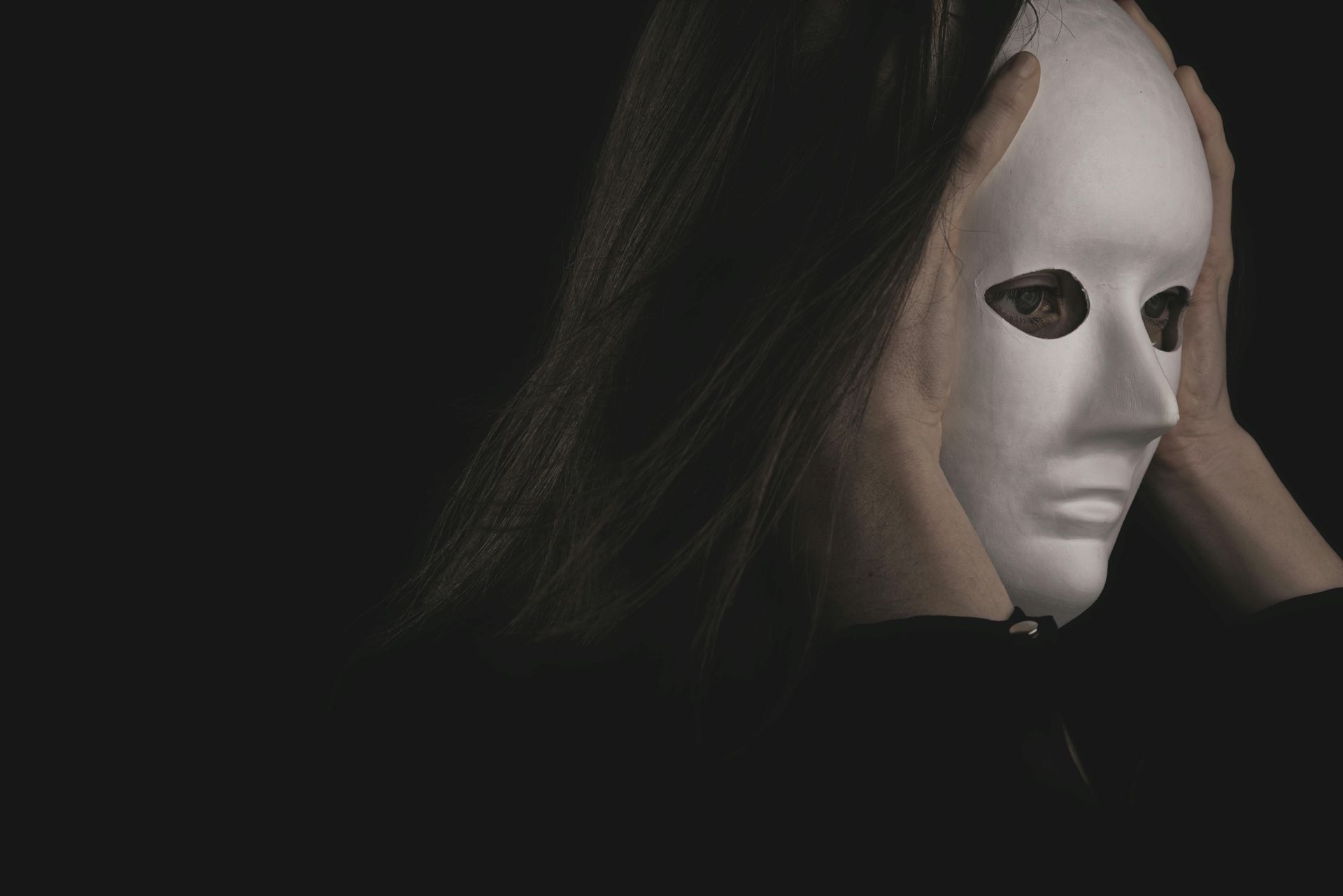





Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Tous les articles