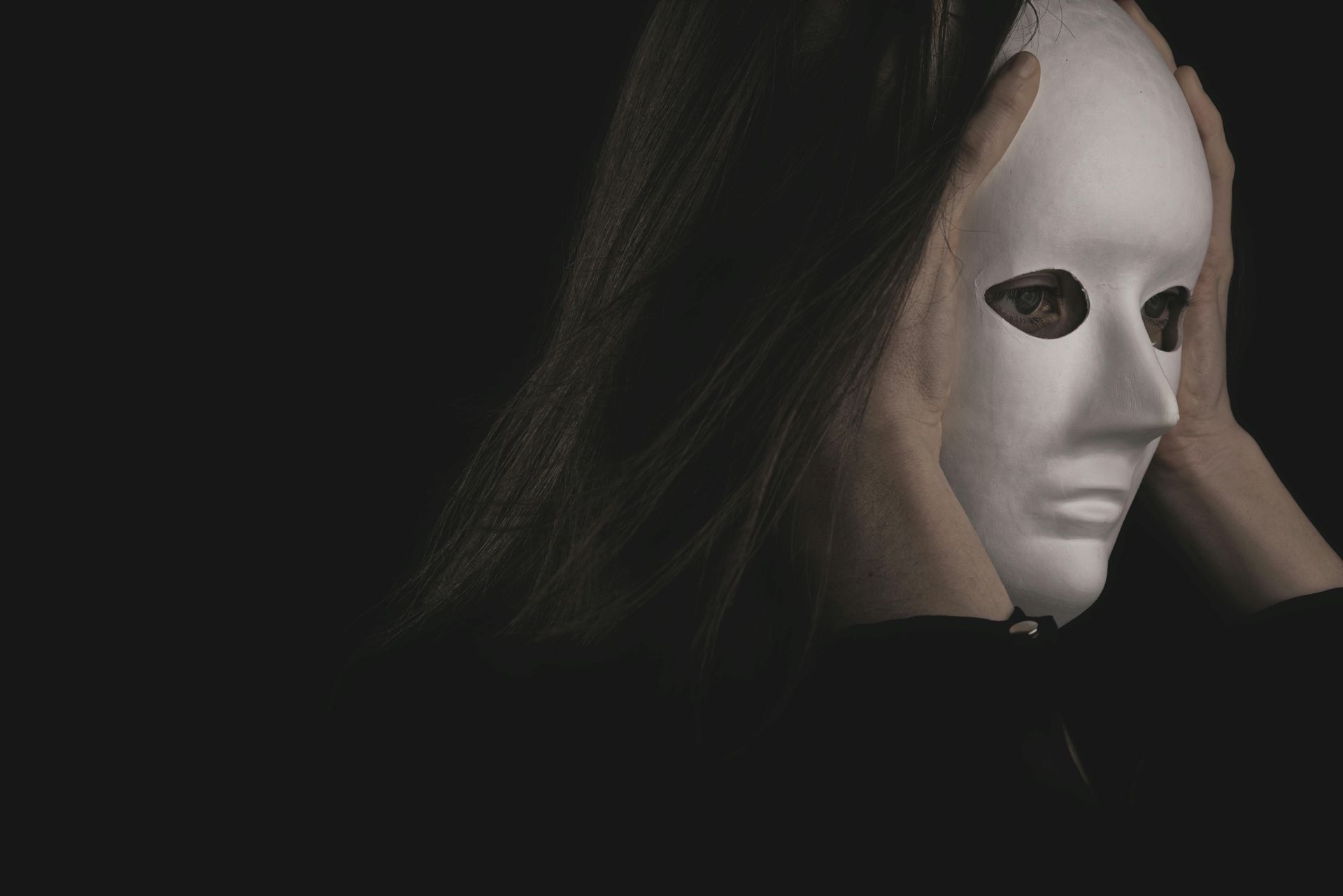Au bout de la laisse : Comprendre les conditionnements dans les relations d’emprise
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Quand l’amour devient piège
Pourquoi certaines personnes resteraient-elles enfermées dans une relation qui les détruit ? Pourquoi reviendraient-elles vers un partenaire qui les humilie, les contrôle, voire les agresse ? Ces comportements, qui défient la logique de l’intégrité, ne sont ni des faiblesses ni de simples « mauvais décision ». Ils sont souvent l’aboutissement d’un processus d’apprentissage, comparable à celui d’un animal qui apprend, sans le vouloir, à craindre ou à espérer selon les réactions de l’environnement.
Dans cet article, nous proposons de décrypter les mécanismes de conditionnement – classique (Pavlovien) et opérant (Skinnérien) – lorsqu’ils sont mobilisés dans des dynamiques d’emprise pathologique. Il ne s’agit pas de réduire la complexité humaine à des schémas comportementaux, mais d’éclairer comment, au fil des expériences et des réponses de l’environnement, certaines personnes peuvent apprendre à tolérer l’intolérable, supporter l’insupportable, à se résigner, ou à confondre l’attachement avec l’amour.

Avant d’entrer dans le vif
Ces mécanismes de conditionnement ne sont pas en soi pathologiques : ils sont même relativement banaux dans nos apprentissages et adaptations affectifs et relationnels. Dans toute relation, y compris saine, nous apprenons à ajuster nos comportements en fonction de l’autre — par désir, par respect, par crainte, par attachement ou par amour. Ce sont des dynamiques intersubjectives fondamentales, inscrites dans nos aptitudes à vivre ensemble.
Mais dans une dynamique d’emprise pathologique, ces mécanismes peuvent devenir contre-productifs, dysfonctionnels : ils ne servent plus la relation, ni la construction d’un lien réciproque, mais sont détournés au seul profit de l’auteur, pour maintenir son contrôle, imposer ses objectifs affectifs ou matériels, et neutraliser la parole ou le désir de l’autre. Ce n’est plus une danse à deux, c’est un engrenage à sens unique.
Ces mécanismes peuvent être qualifiés d’universels. L’auteur de l’emprise lui-même est également conditionné — souvent à son insu — par ses propres logiques délirantes, son instabilité narcissique ou égocentrique ou ses failles structurelles profondes. Ce qu’il impose à l’autre est aussi une réponse mal élaborée à ce qui le hante dans propre manière de fonctionner : il agirait pour ne pas sombrer, mais en entraînant l’autre dans sa chute déguisée.
Apprendre à se taire : quand la peur devient réflexe
Le conditionnement classique, mis en lumière par Pavlov (1927), repose sur l’association répétée entre un stimulus neutre et un stimulus porteur d’une charge émotionnelle - un stimulus est un élément venant de l’extérieur ou interne à l’individu qui active une réponse.
Je me souviens d’une femme qui racontait avoir vécu des scènes violentes, à plusieurs reprises, chaque fois que son compagnon fronçait les sourcils. Elle avait finit par ressentir de l’angoisse rien qu’en voyant ce même froncement de sourcils, même en dehors de toute violence ou conflit.
Décomposition pavlovienne :
- Stimulus inconditionnel (SI) : la scène violente, qui provoque de l’angoisse.
- Stimulus neutre devenu conditionnel (SC) : le froncement de sourcils.
- Réponse inconditionnelle (RI) : angoisse face à la violence.
- Réponse conditionnée (RC) : angoisse déclenchée uniquement par le froncement de sourcils, même en l’absence de violence.
Le stimulus initialement neutre (le regard fermé, les sourcils froncés, un pas lourd) devient un signal de danger par simple association répétée avec une scène pénible. Il ne s’agit pas d'une conséquence d’un acte de sa part, mais une réponse automatique de l’appareil psychique à une image, un son, un ton devenu porteur de menace.
Dans les cas d’emprise pathologique, ce mécanisme peut être souvent à l’œuvre dès les premières tensions. Des signes apparemment anodins deviennent des signaux d’alarme. Et la réaction se déclenche avant même que la violence n’advienne. Le corps anticipe, s’adapte, évite — et désapprend à exprimer. La victime, pour se protéger, finit par taire sa pensée avant même d’en prendre conscience. Ce n’est plus seulement une défense, c’est une forme d’aménagement existentiel, une adaptation à l’environnent.

Aimer sous conditions : les pièges du renforcement intermittent
Avec le conditionnement opérant, théorisé par Skinner (1953), ce n’est plus l’association passive de stimuli qui importe, mais la manière dont les conséquences d’un comportement renforcent ou inhibent sa répétition. Un comportement renforcé positivement — par exemple, recevoir une marque d’affection après avoir évité un conflit — a plus de chances de se reproduire.
Renforcement positif : le piège de la récompense
Claire vivait une relation dans laquelle son compagnon se montrait le plus souvent froid, critique, distant. Pourtant, il lui arrivait parfois — et presque uniquement dans certains contextes bien particuliers — de redevenir doux, attentionné, voire tendre. Ces moments rares survenaient généralement lorsqu’elle se taisait pendant ses colères, ou lorsqu’elle renonçait à contester, à se défendre, à poser une limite. Progressivement, sans que cela soit explicite, elle en venait à associer le retour au calme et à l’affection avec sa propre capacité à s’effacer. Pouvons-nous encore appeler cela de l’affection ?
C’est à ce prix — celui de l’oubli de soi, de l’auto-censure, du silence — qu’elle pouvait espérer retrouver un peu de lien, de chaleur, de sécurité affective. Elle ne se sentait pas libre, mais elle restait, sous tension, dans l’attente de ces « bons moments » qui venaient valider l’idée qu’il était, sans doute, encore capable d’amour. Il ne s’agit pas d’un choix lucide : c’est un apprentissage émotionnel conditionné, fondé sur un renforcement positif pervers. La tendresse, ici, fonctionne comme une récompense venant renforcer, encore et encore, des conduites de soumission et d’effacement.
Renforcement négatif : l’évitement de la punition
Sophie avait appris, à force de tensions, de cris ou de silences méprisants, que poser une question à son compagnon sur son emploi du temps, ses absences ou ses incohérences, risquait de déclencher une explosion. Pas toujours, mais assez souvent pour que son corps le sache avant même qu’elle y pensait. Alors, elle ne demandait plus rien. Elle évitait les sujets sensibles, contournait les zones à risque, ajustait son discours, anticipait son ton, parfois même son regard. Elle apprenait à faire disparaître toute forme d’interpellation ou de sollicitation, comme nous apprenons à ne plus poser la main dans un four que nous savons être chaud.
À première vue, cela est efficace, mais quel prix ? les conflits diminuent, les scènes violentes s’espacent, les humiliations se font plus rares. Mais cette accalmie a un coût : celui de son autonomie, de son droit à comprendre, à s’exprimer, à exister dans la relation. C’est un soulagement piégé : nous n’agissons plus pour vivre la relation, mais pour éviter ses conséquences. Ce mécanisme est un renforcement négatif, au sens comportemental du terme : le fait de cesser un comportement (questionner, parler, contredire) permet d’éviter une punition psychologique ou relationnelle. Et plus cela fonctionne, plus la stratégie d’évitement s’ancre, jusqu’à devenir une seconde peau : une position sacrificielle exacerbée, une soumission unilatérale aux injonctions de l’autre.
Renforcement intermittent : le piège de l’espoir aléatoire
Le mécanisme le plus puissant, notamment dans les relations d’emprise pathologique, est le renforcement intermittent, identifié dès les années 1950 par Ferster et Skinner (1957). Lorsqu’une récompense est imprévisible — un compliment, une caresse, une attention affectueuse au milieu d’un cycle de maltraitance — elle devient d’autant plus addictive. C’est le principe des machines à sous : ce n’est pas la récompense qui maintient le comportement, mais l’incertitude de son apparition.
Julie vivait une relation marquée par les humiliations, les silences pesants, les remarques blessantes. Son compagnon la dévalorisait, l’ignorait, ou la rabaissait — parfois avec violence, parfois avec un calme glacial. Mais de temps à autre, sans logique apparente, il lui offrait un cadeau, l’enlace tendrement, ou lui envoie un message d’amour bouleversant, souvent même au lendemain d’une crise. Ces gestes ne s’inscrivent dans aucune réparation explicite, mais ils ravivent chez Julie le souvenir d’un homme qu’elle a aimé, ou cru aimer.
Ne sachant jamais quand ces moments reviendront, elle s’accrochait à eux comme à des bouées émotionnelles. Elle attendait, s’ajustait, se faisait plus discrète, convaincue que le retour de l’affection dépendait peut-être d’un bon comportement de sa part, même si elle ne parvenait pas à comprendre lequel. Nous retrouvons ici une forme de double contrainte - il n’existe aucune bonne réponse à offrir à l’autre pour maintenir un lien de qualité. L’enjeu n’est pas la résolution du conflit. L’existence des tensions est la fin en soi. Peu à peu, ce lien devient une loterie affective, où les signes d’affection, bien que rares, deviennent d’autant plus précieux qu’ils sont imprévisibles. L’incertitude elle-même devient une stratégie de contrôle.
Ce mécanisme illustre ce qu’on appelle en psychologie comportementale un renforcement positif intermittent : la récompense (tendresse, attention, réassurance) survient de manière aléatoire, sans lien stable avec un comportement donné. Et c’est précisément cette irrégularité qui rend, en plus d’autres facteurs, la relation si difficile à quitter. Le système de récompense du cerveau, piégé dans l’espoir, rend l’attente plus addictive que le lien lui-même. Le peu devient tout. Et le rien, insupportable. Ainsi, les quelques cacahuètes que l’autre nous lance deviennent le repas, l’insatisfaction n’est à force plus permise. C’est notamment ainsi qu’à travers les « pour le moment ça va mieux », il est peut-être pertinent d’entendre une pause dans la dynamique du renforcement, un retour au statu quo avant la reprise du cycle.
Dans une relation d’emprise pathologique (lien ou relation toxique), les quelques moments d’attention ou de tendresse renforcent le comportement d’attente, de retour ou de soumission, même si ces moments sont rares. Cela crée un lien de dépendance où l’autre devient à la fois source de douleur et d’illusion de réparation. La personne victime est conditionnée à espérer.

Quand la violence devient la norme : l’habituation
Les mécanismes d’habituation, souvent utilisés en thérapie cognitive comportementale (TCC) pour réduire les phobies, deviennent pervers dans le contexte d’emprise pathologique. Ce mécanisme postule que, face à une exposition répétée à un stimulus désagréable ou agréable, la réaction somatique et psychologique diminue. Dans ce cas, l’accoutumance nous pousse à augmenter les doses pour que le produit fasse encore de l’effet.
Cela est utile dans un accompagnement psychothérapeutique ou médicamenteux. Mais dans une emprise pathologique, cela rend la violence supportable. L’auteur peut même être amené à augmenter son agressivité, lorsque sa victime semble moins réagir à ce qui jusqu’à lors fonctionnait.
À force d’entendre des remarques humiliantes, un homme en vient à ne plus les percevoir comme telles. Il les « intègre », les justifie, les banalise. Ce n’est pas de la résilience, c’est une anesthésie émotionnelle. Une forme de dissociation affective, proche de ce que décrit Judith Herman (1992) : un effondrement des repères internes, où le Sujet ne sait plus s’il souffre ou non.
Répéter sans comprendre : quand l’attachement devient piège
Dans une lecture psychanalytique, le comportement conditionné n’est pas seulement une réponse à l’environnement, mais aussi une mise en scène inconsciente d’une histoire passée. Lacan (1966) insiste sur la répétition comme mise en acte d’un savoir insu. On ne répète pas seulement ce qu’on a vécu, mais ce qu’on n’a pas pu symboliser (les évènements passés pour lesquels nous n’avons pas su donner sens).
Ainsi, une personne ayant grandi dans un climat familial désorganisé peut chercher, dans sa vie amicale ou conjugale, un lien qui la rassure… même s’il la détruit. Ce n’est pas un désir de souffrir, c’est une tentative de rejouer, différemment, une scène de perte ou de rejet non résolue.
Dans cette perspective, le conditionnement n’est pas qu’un apprentissage comportemental qui naitrait spontanément de la relation. Il est aussi, depuis plus longtemps, l’inscription corporelle d’une attente inconsciente, qui organise les liens, rejoue les échecs, et résiste à la prise de conscience. Il ne suffit pas de « désapprendre ». Il faut mettre en sens, traverser le symptôme, et parfois le réinterpréter pour s’apprivoiser.
Liens entre trauma, conditionnement et hypervigilance
Les traumatismes complexes, souvent présents dans les parcours de vie des personnes sous emprise pathologique, ne laissent pas que des souvenirs : ils laissent des réflexes. Comme l’a montré van der Kolk (2014), ces réflexes sont corporels, inconscients, et souvent liés à des circuits de survie. Une personne hypervigilante, c’est une personne dont le système nerveux est resté en mode « alerte », à l’affut du danger. Elle est plus sensible aux signaux ambigus, plus réactive au silence, à la tension, aux mouvements brusques.
Ce terrain facilite l’installation du conditionnement. Car là où il y a peur, il y a anticipation. Et là où il y a anticipation, il y a apprentissage automatique. Ce qui devait n’être qu’une stratégie de survie devient un mode de relation. Et la répétition s’installe.

Pistes de prise en charge : ouvrir une brèche dans le système
Sortir d’une emprise pathologique ne consiste pas à « ouvrir les yeux », mais à désactiver les logiques qui la rendent tolérable. Les TCC permettent un repérage des renforcements, des cycles de comportement, des évitements. Elles offrent des outils pour désensibiliser, pour construire des renforcements alternatifs, pour exposer en sécurité. Les moindres petites réalisations, les moindres petites modifications de réponses peuvent amorcer un début de déshabituation, jamais dans la confrontation à l’auteur, mais dans la compréhension, l’observation et la réflexion pour entrevoir le début d'une prise de décision.
Mais dans la clinique de l’emprise pathologique, cela ne suffit pas toujours. Car ce qui maintient le lien, ce n’est pas seulement le schéma, c’est notamment
le manque, l’inscription subjective ou encore le désir d’être reconnu. C’est là que la parole prend toute sa place : pour nommer, relire, déplacer. Et parfois pour réassigner le symptôme à son auteur. Lacan dirait que ce n’est pas l’événement qui fait le Sujet, mais la façon dont il est pris dans le symbolique — c’est-à-dire le moment où quelque chose de l’expérience prend sens pour quelqu’un, en y reconnaissant quelque chose de son histoire, de son désir ou de sa position dans le monde. C’est ce moment où l’expérience cesse d’être seulement subie pour devenir pensée, ressentie, nommée — en tant que sujet.
Un trauma, par exemple, ne devient traumatique que s’il ne trouve pas d’inscription subjective : l’évènement n’est pas un souvenir, il reste à l’état de trou, d’effraction, de reviviscence.
Un cadre thérapeutique qui ne juge pas, qui ne « corrige » pas trop vite, qui offre une autre temporalité, est indispensable. C’est dans ce tiers, non conditionnant, que peut émerger une forme de liberté.
Quand l’absence devient présence : la persistance des conditionnements après la séparation
Nous pourrions croire que la séparation signe la fin du conditionnement. Qu’en se libérant physiquement de la personne exerçant l’emprise pathologique, la mécanique de contrôle s’éteint, que le conditionnement n’est plus ! Pourtant, ma clinique montre l’inverse : chez de nombreuses personnes, les réflexes conditionnés, les affects de peur, les comportements d’évitement ou les sentiments de soumission continuent de se rejouer bien après, voire bien après la fin apparente de la relation. C’est que l’auteur n’a pas forcément disparu ; il a souvent simplement changé de forme, de canal, de stratégie. Paradoxalement, son absence physique peut devenir une modalité d’omniprésence psychique, entretenue par l’ombre portée de son pouvoir. Ce que j’appelle les restes.
Chez plusieurs de mes patient.e.s, la sonnerie d’un téléphone, un mail, un WhatsApp à n’importe quelle heure ou un courrier administratif provoquent des sueurs froides, des crises d’angoisse ou une sidération soudaine. Je précise que la réaction s’active indépendamment et même avant la réelle prise de conscience du contenu du message. Ces réactions ne sont pas exagérées : elles traduisent une mémoire traumatique active, mais aussi un conditionnement émotionnel solidement ancré, souvent par renforcement intermittent. L’imprévisibilité des agressions passées — cris, menaces, sarcasmes, attaques voilées ou frontales — a créé une hypervigilance permanente. Tout peut à nouveau advenir, à tout moment. La moindre notification redevient un stimulus conditionnel (SC), potentiellement annonciateur de danger, réactivant des réponses conditionnées (RC) de peur, d’évitement ou de sidération, comme l’ont modélisés Pavlov (1927/2003) et Foa et Kozak (1986) dans leurs travaux sur la mémoire conditionnée.
Ce conditionnement post-relationnel est souvent entretenu par les dispositifs mêmes censés protéger la victime : procédures judiciaires à rallonge, droits parentaux mal encadrés, conventions de garde à la carte, comptes partagés, ou plateformes de communication obligatoires. Autant de canaux qui, au nom du « lien parental » ou de « l’intérêt supérieur de l’enfant », deviennent des outils de harcèlement déguisé, de pressions psychologiques, ou de simples intrusions répétées. La temporalité de la procédure devient une extension de la mainmise : chaque échéance, chaque convocation, chaque nouveau mail devient un rappel implicite du pouvoir de l’auteur, toujours en capacité de faire irruption dans la vie de la victime. La répétition de ces stimuli entretient une spirale de conditionnement qui fige la victime dans une posture d’anticipation, de prudence ou de repli.
Dans ce contexte, le travail thérapeutique ne peut se limiter à la seule analyse du passé ni à la gestion émotionnelle. Il s’agit aussi d’un travail de déconditionnement actif, où l’on vient modifier les postures psychiques et comportementales face aux stimuli associés à l’auteur. Cela passe par une réappropriation du temps, une mise à distance des canaux de communication — quand cela est possible — et une réorganisation de la vie quotidienne de manière à restreindre les interférences de l’auteur avec la trajectoire de reconstruction.
C’est pourquoi, dans ma pratique, je recommande quasi systématiquement de ne rien laisser en commun après une séparation en contexte d’emprise pathologique : ni comptes bancaires partagés, ni organisation parentale floue, ni zones de négociation ouvertes. Il n’y a aucune raison rationnelle de croire qu’un auteur incapable de tempérance et de constructivité avant la séparation le deviendrait après. L’idée selon laquelle la séparation suffirait à faire naître un parent coparental fiable relève souvent du fantasme.
À l’inverse, poser un cadre ferme, prévisible et unilatéral — validé juridiquement si nécessaire — permet à la victime de réduire les occasions de contact non maîtrisé, et donc les stimuli susceptibles d’entretenir le conditionnement. Ce travail est progressif, complexe, et ne peut faire l’économie d’un accompagnement. Mais il est possible. La reconstruction passe aussi par l’apprentissage de nouvelles réponses, plus affirmées, plus distantes, plus cohérentes avec les besoins de sécurité psychique et d’autonomie. C’est dans cette lente élaboration qu’un nouveau rapport au monde, à soi et à l’autre peut émerger — un rapport dans lequel le passé cesse peu à peu de dicter les réflexes du présent.
Ces aspects cliniques, organisationnels et juridiques feront l’objet d’un prochain article, consacré aux stratégies de communication avec un auteur d’emprise pathologique après la séparation, ainsi qu’à l’accompagnement psychojuridique permettant d’assurer, autant que possible, un véritable sas de sécurité pour les victimes.

Conclusion : le fil de la réinvention
Dans le mythe aztèque, la déesse de la Lune et de la Voie lactée Coyolxauhqui (prononcé Koy-ol-shao-ki) est démembrée par son frère. Son corps éclaté devient le ciel étoilé. C’est une image violente, mais aussi une promesse : ce qui est brisé peut devenir cosmos.
Dans l’emprise pathologique, les morceaux sont là : comportements conditionnés, émotions piégées, espoirs trahis, etc. Le travail psychothérapeutique consiste aussi à recomposer ces fragments, non pour revenir à l’avant, mais pour faire quelque chose de ce qui a été vécu.
C’est ainsi qu’on transforme un conditionnement en mémoire, un trauma en souvenir - une emprise en histoire - un lien en choix.
Bibliographie
Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005). Le pouvoir de guérir : La résilience des enfants traumatisés. Paris : Odile Jacob.
Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press.
Caspar, F. (1995). Plan analysis: A method for treatment planning and outcome evaluation. Psychotherapy Research, 5(1), 45–62. https://doi.org/10.1080/10503309512331331338
Caspar, F. (2007). Plan analysis. In T. D. Eells (Ed.), Handbook of psychotherapy case formulation (2nd ed., pp. 251–289). Guilford Press.
Cyrulnik, B. (2012). Un merveilleux malheur (14e éd.). Paris : Éditions Odile Jacob.
Ferenczi, S. (1932). Confusion de langue entre les adultes et l’enfant [in Œuvres Complètes, Tome IV]. Paris : Payot (rééd. 1982).
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir : Naissance de la prison. Paris : Gallimard.
Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualité 1 : La volonté de savoir. Paris : Gallimard.
Freud, A. (1936/1998). Le Moi et les mécanismes de défense (trad. M. Bonaparte & R. Lindner). Paris : PUF.
Herman, J. L. (1992). Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror. Basic Books.
Hochschild, A. R. (2012). The managed heart: Commercialization of human feeling. University of California Press.
Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. Oxford University Press.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan.
Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3(1), 1–14. https://doi.org/10.1037/h0069608


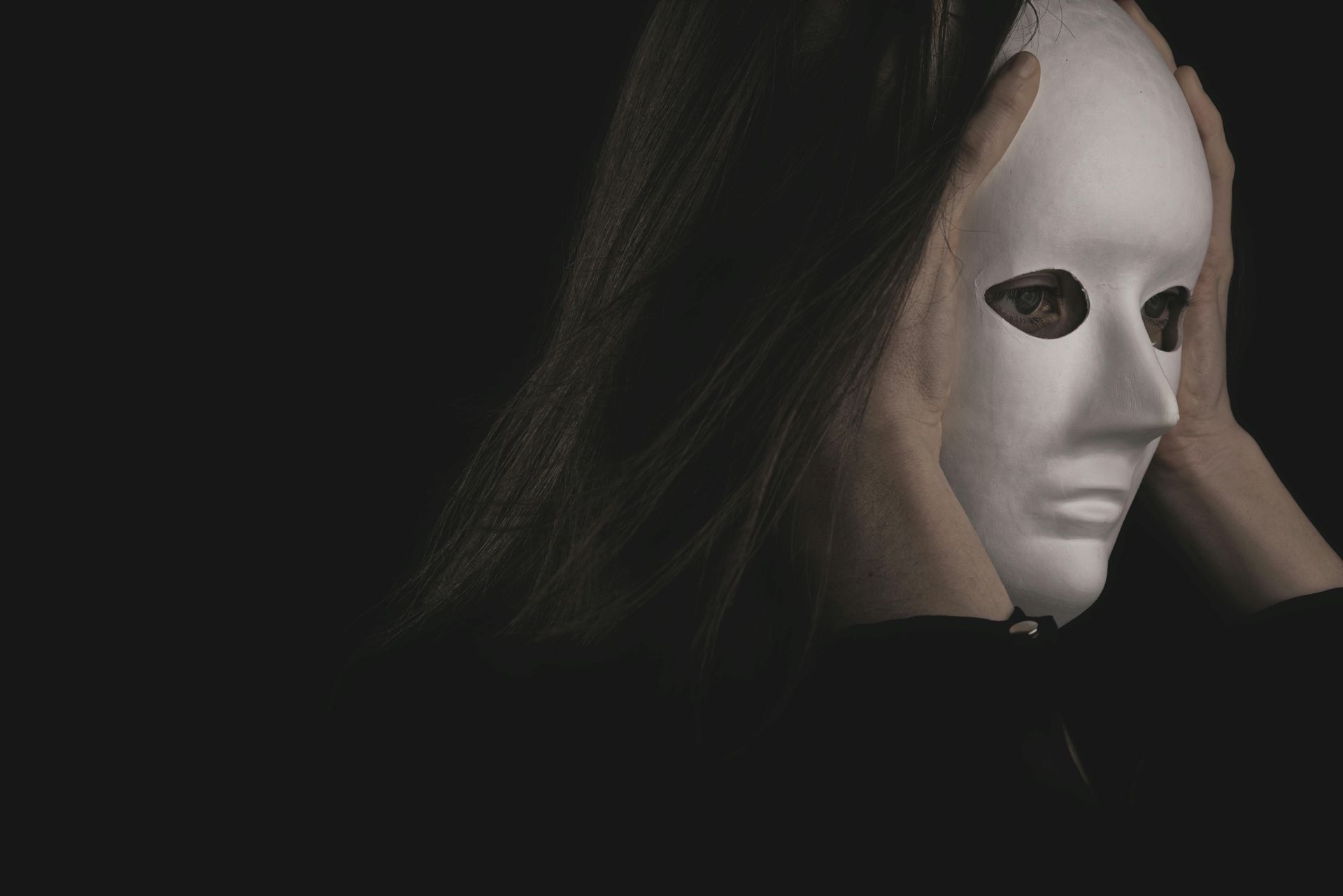
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Tous les articles