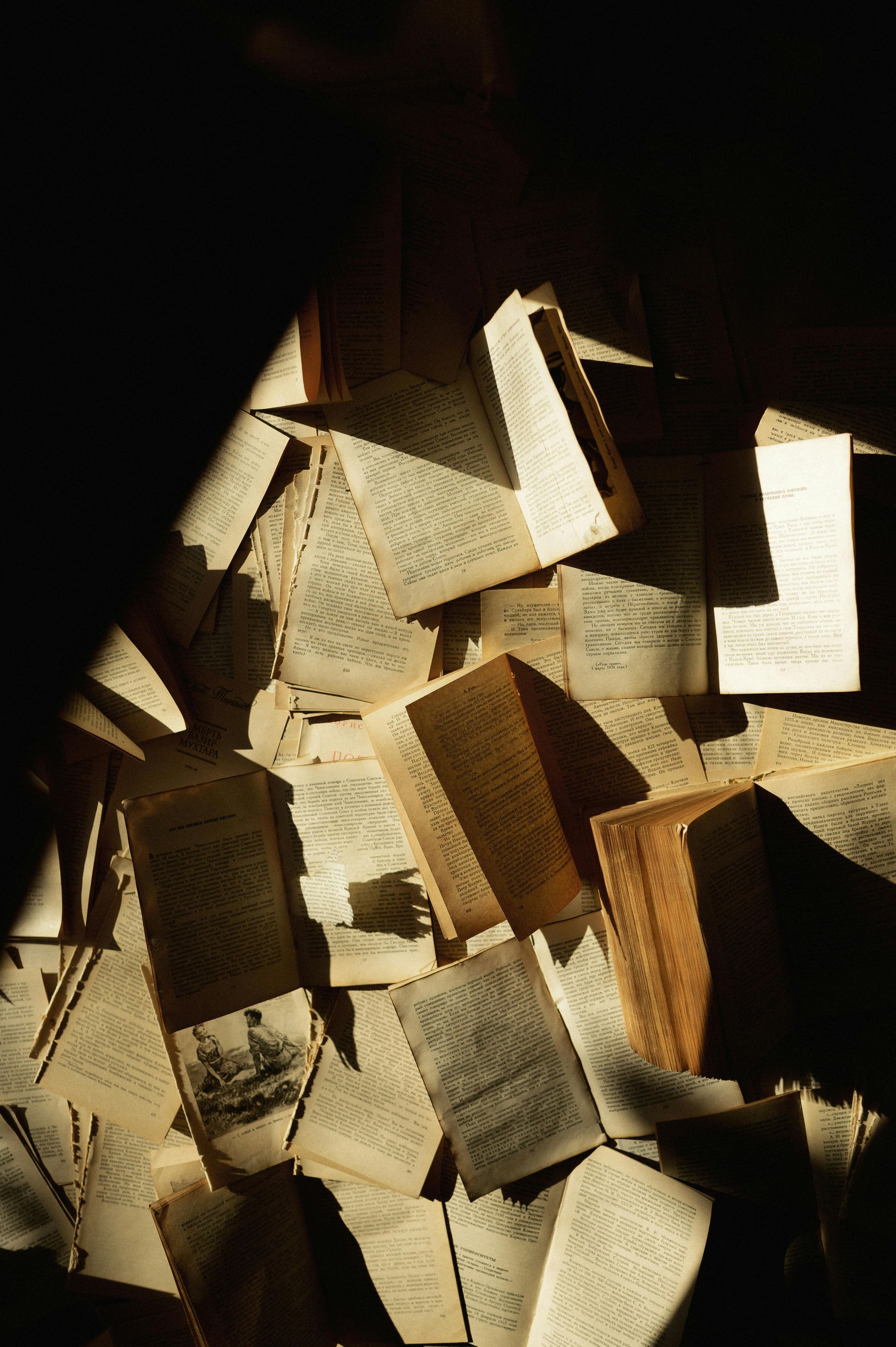Aperçu de la clinique de l’emprise en milieu professionnel : du silence au symptôme collectif
Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Quand le symptôme parle à la place du collectif
Il arrive que les symptômes d’un seul révèlent la vérité d’un groupe. Un salarié s’effondre, un autre somatise, un troisième quitte brusquement son poste. Et autour d’eux, le silence. Rien à signaler. Tout fonctionne. Mais ce “tout fonctionne” sonne creux, comme ces façades qui tiennent debout alors que les fondations ont cédé.
Dans certaines institutions, l’usure n’est pas due au manque de moyens ou à la surcharge de travail. Elle vient d’ailleurs. D’un lieu plus insidieux, plus diffus, moins visible : l’organisation elle-même devient lieu d’emprise, non parce qu’elle serait explicitement malveillante, mais parce qu’elle empêche toute élaboration du réel. Ce qui ne peut se dire se loge ailleurs — dans les corps, dans les démissions, dans les clivages.
Ce que je propose ici, ce n’est pas un traité sur le harcèlement moral ou le management toxique. C’est une tentative de
penser l’imperceptible : les formes d’emprise douce, de glissements symboliques, d’effacements progressifs du sujet, au sein même d’environnements dits « bienveillants ». Ce texte s’appuie sur ma pratique de supervision en entreprise et dans le secteur associatif, là où la souffrance ne prend pas toujours le visage qu’on attend.

L’emprise comme modalité d’organisation silencieuse
L’emprise ne commence pas avec la domination directe. Elle s’installe souvent dans des espaces symboliquement appauvris, où le langage est réduit à la fonction, la parole à l’information, la subjectivité à une variable à maîtriser. Progressivement, le travail devient un lieu sans conflictualité apparente, mais saturé de contraintes implicites.
On demande d’être « agile », « positif », « engagé » — sans poser la question de ce que cela coûte. Le désaccord est perçu comme un défaut de loyauté. L’erreur, comme une faille à réparer. L’angoisse, comme un problème individuel à réguler par des formations en “gestion du stress”. Dans ces contextes, le lien au tiers est dissous : plus personne ne nomme, ne tranche, ne symbolise (Kaës, 2009).
C’est cette absence de tiers — au sens de Loi, d’instance capable de poser des limites — qui crée les conditions d’une emprise institutionnelle. Non pas dans la violence manifeste, mais dans l’effacement progressif du Sujet, remplacé par un moi adapté, conforme, performant.
Du silence à l’implosion : quand le sujet somatise l’institution
Ce que l’institution ne peut penser, elle le délègue au corps des individus. Burn-out, troubles anxieux, insomnies, attaques de panique… Ces symptômes ne sont pas des dysfonctionnements personnels. Ils sont des réponses au déni collectif du conflit. L’individu “pète les plombs” là où l’organisation se tait.
Je pense à cette cadre supérieure, brillante, engagée, respectée, qui du jour au lendemain s’est effondrée. Ni harcèlement, ni surcharge explicite. Mais un climat fait de sourires glacés, d’objectifs mouvants, de demandes paradoxales : « soyez autonome » mais « rappelez-moi pour chaque décision ». Un discours d’autonomie doublé d’un contrôle constant, typique de la double contrainte (Bateson, 1972).
La clinique de l’emprise en entreprise, c’est cela : un espace où la parole est remplacée par des injonctions, où le sujet n’a plus d’espace pour dire “non”, pour douter, pour poser ses limites sans être disqualifié. Ce n’est pas le trop-plein de travail qui épuise, mais l’impossibilité de symboliser ce qui traverse.
Disqualifications symboliques, faux liens et désinsertion subjective
L’emprise se loge aussi dans les relations dites « humaines ». On se tutoie, on se félicite, on s’envoie des smileys dans les mails. Et pourtant, une parole critique est vécue comme une trahison. L’équipe devient un “nous” collé, intrusif, où la différence devient suspecte. Le conflit est évacué au nom de la cohésion, l’angoisse tue au nom du bien-être. L’institution produit alors des faux liens : des rapports sans altérité réelle, sans possibilité d’écart, sans droit à la solitude.
Le salarié pris dans cette dynamique n’est pas nécessairement victime. Il devient souvent lui-même acteur de l’emprise, s’y pliant pour survivre, disqualifiant celles et ceux qui résistent. Le collectif est alors traversé par des loyautés invisibles (Kaës, 2012), des formes d’adhésion inconscientes à un système qui broie lentement ce qu’il valorise officiellement.
Là où il n’y a plus d’espace pour dire l’écart, le sujet se désinsère de lui-même. Il tient, mais en mode défensif. Il agit, mais sans désir. Il parle, mais plus jamais de lui.
Sortir de l’emprise : parole, conflit et mise en tiers
Il n’y a pas de sortie simple à l’emprise. Ni solution miracle. Mais il y a des gestes symboliques qui déplacent. La supervision — individuelle ou collective — peut jouer ce rôle de tiers. Pas pour “résoudre” les problèmes, mais pour permettre qu’ils soient enfin pensés comme symptômes et non comme défauts individuels.
Superviser, c’est redonner droit au conflit, au doute, à la pluralité des points de vue. C’est remettre du langage là où tout a été ramené à des procédures. C’est réintroduire du sujet dans ce qui était devenu pur fonctionnement. Ce n’est pas confortable. Parfois, cela dérange. Cela déclenche même des résistances violentes. Mais c’est dans ces mouvements que le lien redevient vivant.
Je me souviens d’une supervision en milieu hospitalier où le simple fait qu’une infirmière ose dire “je ne comprends plus le sens de ce que je fais” a tout fait basculer. Il y a eu des larmes. Des départs. Mais aussi une réorganisation, une reprise du dialogue, une reformulation du cadre.
C’est la parole — pas la réforme — qui a réouvert du possible.

Conclusion : Rejouer sans répéter — vers une clinique de la parole au travail
L’emprise en milieu professionnel ne se détecte pas toujours dans les rapports ou les organigrammes. Elle s’entend dans ce qui ne peut plus être dit. Elle se lit dans les silences trop lourds, les symptômes à répétition, les liens figés ou fusionnels.
Y répondre ne relève pas uniquement des RH ou des audits externes. Cela suppose un travail clinique, au sens plein du terme : un espace où l’on puisse mettre en tension, entendre les conflits, traverser les projections, relancer du sujet.
Ce que je défends ici, ce n’est pas une posture d’expert extérieur, mais une position de tiers impliqué, capable d’entendre ce que l’organisation rejette. Une clinique du lien, du langage, de la limite. Une pratique où l’on ne cherche pas à réparer vite, mais à rendre au travail sa dimension humaine, symbolique, et conflictualisée.
Parce que là où tout est lissé, il n’y a plus que des morts-vivants. Et là où le Sujet revient, même fragile, même traversé d’ambivalence, il y a du vivant à nouveau possible.
Bibliographie
Bateson, G. (1972). Vers une écologie de l’esprit. Seuil.
Kaës, R. (2009). Le lien d’alliance en psychanalyse. Dunod.
Kaës, R. (2012). Les alliances inconscientes. Dunod.
Roussillon, R. (2008). Le travail de l’inconscient dans les institutions. PUF.
Stroobandt, T. (2025). Tenir la parole dans l’intime : la supervision individuelle des praticiens.
Winnicott, D. W. (1971). Jeu et réalité. Gallimard.



Si cet article vous a parlé, il parlera peut-être à d’autres. Partagez-le.
Tous les articles